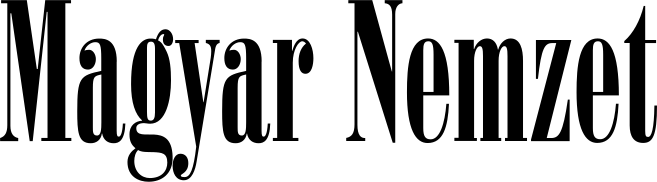Le règne du droit s’applique aussi à l’Union européenne, et le Parlement ne peut pas en être exempté
József Szájer, chef de la délégation Fidesz–KDNP au Parlement européen, montre, entre autres, comment l’activité du Parlement européen en rapport avec l’état pandémique se heurte frontalement aux exigences de l’état de droit.
L’état de droit est la situation dans laquelle le droit règne sur les hommes, c’est-à-dire le principe selon lequel il faut respecter les règles, l’application du droit ne pouvant varier d’une personne à l’autre. Le règne du droit signifie que ce ne sont pas des hommes qui dominent les autres hommes, mais que le maître est le droit, qui – à la différence des individus, qui souffrent souvent de partialité – mesure tout d’une aune équitable, juste et impartiale.
La démocratie et les principes de l’état de droit tenant constamment en respect la volonté de la majorité, à condition d’être en équilibre, sont ensemble en mesure de garantir l’harmonie entre volonté sociale et droits des citoyens et des minorités, et, par là, la paix sociale. Mais pour peu que cet équilibre se rompe soit d’un côté, soit de l’autre, cela peut facilement mettre en danger l’état démocratique moderne. Une pratique législative ignorant les droits de l’individu et de certaines communautés est susceptible de provoquer d’importants mécontentements et conflits sociaux, tandis qu’une application excessive des principes de l’état de droit sape la marge de manœuvre des gouvernements et ruine la confiance que les gens placent dans leurs institutions démocratiques. Nous autres, Hongrois, connaissons bien ces deux situations, pour en avoir vécu des cas exemplaires.
Peur du nationalisme et de l’arbitraire des majorités
Depuis la chute du communisme, la question de l’état de droit n’a jamais cessé d’être à l’ordre du jour. Pour nos sociétés qui venaient, en 1989–1990, de reconquérir leurs libertés, le pluralisme et les élections libres, la démocratie, la décision par la majorité était une valeur primordiale et indubitable. Ceux qui, depuis l’Ouest, favorisaient et influençaient ce processus ont, dès le début, tenu à ce que le principe majoritaire de la démocratie soit tempéré par un système d’institutions chargées de tenir en laisse le « nationalisme » et le risque d’une volonté majoritaire tentée par l’arbitraire : à ce que l’état de droit et la protection des droits fondamentaux soient partie intégrante et active du régime constitutionnel de ces pays.
Or c’est exactement de cette époque que date, à l’Ouest, une autre tendance de fond : les cours constitutionnelles, initialement créées, dans l’esprit de Hans Kelsen, uniquement à des fins d’organisation hiérarchique de l’État, ont de plus en plus largement débordé cette fonction, s’attribuant des compétences de fond, et une mission de protection des droits fondamentaux. Conséquence de cette multiplication à marche forcée de procédures formellement judiciaires ou assimilées, mais constituant de facto des actes législatifs négatifs : on a vu apparaître un danger de rupture de l’équilibre qui régnait entre les pouvoirs, et de dégradation du principe de contrôle réciproque des pouvoirs, dans la mesure où ces instances s’aventuraient toujours plus avant dans un territoire qui était jusqu’alors celui d’actes législatifs à légitimité démocratique, fondamentalement basée sur le choix de la majorité. C’est de cette époque que datent la multiplication des institutions de protection des droits fondamentaux – ombudsmans, cours internationales et autres, dont l’influence prend alors des proportions inédites – et de leurs empiètements sur les prérogatives des instances de l’État-nation, au moyen de réglementations molles et de procédés argumentatifs non dénués de dangers du point de vue de la sécurité juridique.
Certains ont vu dans les pays qui venaient alors de recouvrer leur liberté un terrain d’exercice particulièrement bien adapté à la mise à l’épreuve de constructions de ce genre : citons, par exemple, en Hongrie, l’établissement de quatre ombudsmans différents, la création à marche forcée de systèmes judiciaires autonomes, endogames, au mépris du principe de contrôle réciproque des pouvoirs, la création de parquets spéciaux comme en Roumanie, l’omnipotence inédite accordée, en Hongrie ou encore en Pologne, aux cours constitutionnelles, ou encore l’indépendance des banques centrales, et ses garanties juridiques excessives, souvent déraisonnables et compliquant plutôt qu’elles ne la facilitent leur collaboration rationnelle avec l’exécutif.
La pierre angulaire de la démocratie européenne
Certaines de ces institutions de « l’état de droit » sont des exemples parlants de psittacisme juridique éclectique pratiqué au mépris des racines historiques, d’interprétation excessive des idées de l’état de droit, d’affaiblissement voulu des pouvoir exécutif et législatif. De même qu’elles sont de bonnes illustrations des notions de confusion conceptuelle, de paresse intellectuelle, de mentalité coloniale et de gouvernement sous pression. Elles dévoilent des menées de nature idéologique, semi-doctes et politiquement influencées, le mépris du pouvoir démocratique de la majorité, et parfois aussi la peur panique qui s’empare de certaines élites, et de certains groupements politiques perdant du terrain, devant la puissance du demos.
Les considérations d’état de droit doivent être appliquées de façon unitaire à toutes les institutions. Aucun corps doté de pouvoirs ne peut s’y dérober. C’est ainsi qu’ont été introduits (entre autres) dans la législation communautaire les principes d’état de droit, de droits fondamentaux, qui protègent les citoyens de l’arbitraire législatif, y compris au niveau des institutions de l’Union : c’est l’objectif de la Charte des droits fondamentaux. L’Union n’étant pas un État, mais un organisme fonctionnant en vertu d’un contrat spécial, elle n’a jusqu’à présent pas été en mesure de satisfaire totalement aux exigences de la démocratie et de l’état de droit, et – dans la mesure où certaines conditions pré-requises lui font défaut –, d’un certain point de vue, elle ne sera d’ailleurs jamais en mesure d’y satisfaire pleinement. De tous les éléments de légitimation démocratique de l’Union, la composante la plus importante et la plus forte, la pierre angulaire de la démocratie européenne, sa garantie de dernier recours reste l’élection libre, au scrutin majoritaire, des assemblées législatives des États membres. Au bout de plusieurs décennies d’existence, le Parlement européen, comme institution pseudo-représentative, reste incapable de compenser efficacement le déficit démocratique sui generis de l’Union, la faiblesse de sa légitimité démocratique interne.
Entre temps, les institutions centrales de l’Union ont même résisté activement à la nécessaire imposition d’un contrôle du respect de l’état de droit dans le cadre de leurs activités. Au cours de ces dernières années, tandis qu’elles-mêmes formulaient de telles critiques à l’encontre des États membres, elles ont neutralisé, les unes après les autres, les moindres tentatives de leur imposer un contrôle externe. Ignorant les garanties, outrepassant agressivement les limites que leur imposait le principe de subsidiarité, elles ont traité et conformé tous les systèmes visant à réduire le déficit démocratique de l’Union de façon à s’assurer que ces derniers ne puissent en aucun cas menacer leur pouvoir. La tentative, via le traité de Lisbonne, d’octroyer aux parlements nationaux un droit d’intervention dans l’activité législative de l’Union s’est soldée par un échec spectaculaire. Non moins que l’initiative citoyenne européenne, soumise à la condition de rassembler un million de signatures. Durant la dernière décennie, au cours de laquelle ces règles ont été en vigueur, elles n’ont pas produit le moindre exemple de succès. Confrontées à des initiatives tendant à compenser leur pouvoir, et qui n’étaient pas de leur goût, les institutions de l’Union les ont purement et simplement écartées d’un revers de la main.
Un rapport Sargentini sans base juridique
Il faut donc oser le dire : l’Union est en délicatesse avec le respect de l’état de droit et avec le principe de règne du droit. Le Parlement européen (PE) bricole en fonction de ses intérêts du moment ses règles de décompte des voix, au prix d’une interprétation subversive des traités, en vertu de consignes de service internes d’un rang juridique négligeable : c’est ce qu’on a vu se produire dans le cas du rapport Sargentini, ou quand un siège de vice-président du Parlement a été refusé à un parlementaire polonais mal vu dans la mouvance dominante de l’Union. Le Parlement européen est allé jusqu’à approuver le rapport Sargentini sur la Hongrie, tout en reconnaissant lui-même publiquement qu’en vertu du droit communautaire, il manquait de base juridique pour se prononcer sur de nombreux points dudit rapport.
Dernier exemple en date, non moins choquant : tirant prétexte de la crise causée par le Covid–19, la présidence du PE a instauré un système de vote électronique à distance, à l’encontre du règlement procédural, lequel fait explicitement de la présence des euro-parlementaires une règle de fonctionnement par défaut. Cette grave violation du droit rend discutable la validité de tout vote exprimé au sein du PE à compter de mars 2020. Seule la majorité absolue des parlementaires est habilitée à modifier ou amender le règlement procédural du Parlement, à l’exclusion de tout sous-ensemble de cette assemblée, mais aussi de sa présidence. En outre, le PE ignore aussi souverainement les décisions judiciaires qui l’obligent à célébrer un minimum de douze sessions plénières par an à Strasbourg.
La Commission ne se conduit pas mieux. A l’époque de la Commission Juncker, lors de la nomination du nouveau Secrétaire général de la Commission – même si le nom de putsch conviendrait mieux à cette opération machiavélique – cette dernière a adopté une interprétation « créative » des règles auxquelles elle est sujette ; puis, lorsque le Parlement a adopté une résolution critiquant cet abus, mue par une étrange conception de la solidarité au sein de l’Union, elle en est resté à une moue de désapprobation, indolore, ne conduisant à aucune sanction, et revenant pour l’essentiel à entériner le fait accompli d’une forfaiture.
Des institutions européennes hors contrôle
La Commission s’est mise à rédiger des rapports annuels sur la situation de l’état de droit dans les États membres. Détail plus qu’éloquent : aucun rapport de ce genre n’est rédigé sur le fonctionnement des institutions de l’Union – que ce soit la Commission, le Parlement, le Conseil etc.. Bien évidemment pas parce qu’on n’y rencontrerait aucun problème de ce genre. La réalité, c’est que tout le monde omet soigneusement de mentionner que le principe d’état de doit mentionné par l’article 2 leur est également applicable !
A dire vrai, il s’applique même prioritairement aux institutions de l’Union.
Dans ces conditions, on s’étonnera moins de voir les institutions centrales de l’Union préférer appliquer aux États membres des règles afférentes à l’état de droit initialement prévues pour elles. S’agissant des mécanismes de contrôle de l’état de droit – et notamment de ceux, discutés très en détail ces derniers mois, instituant une conditionnalité liée à l’état de droit –, les divers textes, motions et propositions discutés au sein des diverses institutions au cours de la décennie écoulée s’occupent à peine des assemblées législatives et exécutives de l’Union elle-même. Quand il s’agit de leur propre fonctionnement, elles font peu de cas de l’état de droit, étant donné que le véritable objectif du parcours d’obstacles qui porte ce nom est la mise au pas des États membres, l’extension des prérogatives de l’Union au détriment des compétences nationales, c’est-à-dire l’exercice de pressions politiques ou financières à peine voilées, ainsi que la promotion des stupidités de l’agenda fédéraliste.
Que leur vernis d’équité et les apparences de l’impartialité ne trompent personne ! On peut identifier avec précision les égoïsmes institutionnels, idéologiques et partisans, et délimiter les intérêts particuliers de certains groupes d’États membres qui ont débouché sur l’écriture du scénario en fonction duquel doivent être menées les opérations punitives et disciplinaires présentes et futures contre la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Tchéquie.
C’est exclusivement notre région qu’on critique
On peut ici également surprendre en flagrant délit le rapport asymétrique de pouvoir et d’influence marquant depuis le tout début les relations est-ouest au sein de l’Union : qu’il s’agisse des initiatives passées ou présentes, ou de celles qui n’existent encore que sur le papier, elles visent toutes – sans exception aucune – les États membres qui ont adhéré au cours des années 2000. Pendant ce temps, les cas occidentaux glissaient sous le radar dans un silence assourdissant, témoignant d’une cécité sélective intentionnelle et éloquente : les résultats frauduleux des présidentielles autrichiennes – en contradiction flagrante avec l’état de droit –, la répression policière brutale des Gilets Jaunes en France, ou encore la bavure fatale des services de police belges à l’encontre d’un citoyen slovaque.
On sait depuis longtemps – et l’expérience le confirme sans arrêt – que la politique des « deux poids, deux mesures » est le pire ennemi de l’état de droit, de la coopération et de l’égalité. C’est un poison, qui sape la confiance que placent États membres et citoyens dans l’Union.
Osons appeler un chat un chat ! Pour pouvoir discuter de nos affaires européennes communes, nous avons avant tout besoin de clarté : de révéler les arrière-pensées soigneusement occultées, et ces pratiques de triche politique et idéologique.
Notre appartenance à l’Union est pour nous d’une importance vitale, mais nous savons aussi que, si nous ne disposons pas de plans bien arrêtés, si nous reculons devant l’engagement et refusons de risquer de prendre des coups, faute de pouvoir nous constituer en contre-pouvoir efficace, nous nous exposons à ce que les intérêts de nos pays soient ignorés.
Il faut faire table rase de cette union qui, depuis quelques temps, s’est mise à jouer les petits chefs, à sanctionner, à forcer et à ordonner – pour revenir à l’Europe de la libre coopération des nations égales en droit : à cette conception qui a déjà valu à l’Europe tant de succès.
L’Europe ne peut préserver la paix, son influence, sa force et sa prospérité hors du commun qu’en s’appuyant sur des nations européennes fortes. Dans les bulles cognitives de Bruxelles, beaucoup pensent voir dans les rapports entre Union et Etats-membres un jeu à somme nulle : ils croient que celle-là ne peut être forte qu’à condition que ceux-ci s’affaiblissent. L’histoire prouve le contraire : l’Union européenne ne peut être puissante qu’en se construisant à partir d’États membres puissants. C’est à cette condition qu’elle peut redevenir une transaction win-win. Mais à cette fin, la première leçon à retenir, c’est que les règles de l’état de droit doivent aussi s’appliquer aux institutions de l’Union. Pas de « deux poids, deux mesures » ! Le Parlement ne peut pas non plus faire exception ! L’article 2 du traité fait référence à l’UE tout entière. Il est temps de mettre de l’ordre ! Le Parlement devrait balayer devant sa porte, avant de vouloir réprimander autrui.
József Szájer. L’auteur est un euro-parlementaire du groupe Fidesz.