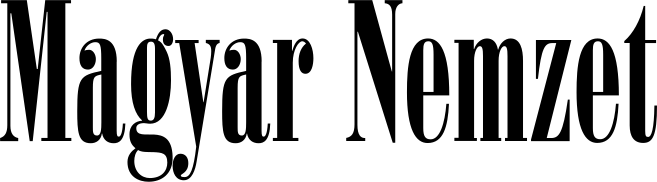Article paru dans le Magyar Nemzet le 8 décembre 2021.
Épigraphe :
« Récemment, j’ai lu une étude américaine sur la révolution industrielle, que nous faisons remonter au premier engin à vapeur, alors qu’en réalité, c’est maintenant qu’elle commence vraiment. Même une fois que le monde se sera débarrassé – ce qui arrivera tôt ou tard – de toutes les conséquences austères de la guerre mondiale, c’est là une secousse tectonique encore plus profonde, sur laquelle le libéralisme des Cobden n’aurait pas davantage d’effet que les visions bibliques d’un Marx. Il faudra la supporter : voilà l’unique conseil de la sagesse. Pour la première fois dans l’histoire humaine, la société agraire devient société industrielle. C’est une mue des plus douloureuses.
Ce qui, dans cette révolution, est le plus difficile à endurer, c’est son effet d’humiliation de l’homme. Cela fait déjà un bout de temps, écrit cet américain, que cette révolution multiplie principalement les travailleur semi-qualifiés (half-skilled). Elle soulage certes le journalier de son fardeau, mais elle ne lui permet pas même de s’approcher de la machine. Tout ce qu’il a le droit de toucher, c’est un de ses écrous. (Tout le monde sait que Chaplin a consacré à cela un film entier.) Le porteur de fardeau va disparaître, mais sa disparition sera suivie de celle du prolétaire romantique, qui était encore l’esclave d’une machine entière ; même la traction du joug et le travail spécialisé constituaient encore un état trop humain, qui devient le privilège de quelques-uns. Sous le commandement d’un état-major de travailleurs spécialisés, c’est un troupeau de visseurs d’écrous qu’on rassemble : le troupeau des travailleurs semi-qualifiés. C’est le pendant du semi-intellect.
J’avoue qu’en lisant cette étude, c’est à ce dernier que je pensais en permanence. A ce chef-d’œuvre de l’enseignement secondaire d’Europe centrale et des cours du soir américains. Keyserling appelait cela le type chauffeur. Mais ce chauffeur est installé à un bureau, et, petit à petit, tous les pays finissent par lui appartenir. Apatride flottant éternellement entre le paysan et l’homme cultivé, il condescend à se rapprocher de l’un en qualité d’agriculteur de l’agriculture planifiée, tout en piétinant l’autre quand il arrive au pouvoir. S’il fallait bécher, il ne tiendrait pas le coup, mais il n’est pas pour autant capable de tailler un pied de chaise, et la lecture d’un livre véritable lui provoquerait un coup de sang » (László Cs. Szabó, Világlázadás [« Révolte mondiale » – n.d.t.]).
Sur ce chemin qu’avait esquissé László Cs. Szabó, nous sommes désormais bien avancés. Sauf que ce « travailleur » n’est plus un travailleur, mais bien plutôt un opérateur. Travailler dans une usine automobile moderne, voire conduire une moissonneuse-batteuse de dernière génération, demande, à n’en pas douter, des connaissances techniques et informatiques absolument incroyables. Apparaissent, pendant ce temps, comme sur bande roulante, des articles et des analyses affirmant que la civilisation technique, l’intelligence artificielle et la robotisation vont rendre superflu le travail de masses d’hommes toujours plus larges, et se demandant ce qu’on pourra bien faire à l’avenir de cette masse « devenue superflue ». Après quoi, les auteurs de ces analyses, le lendemain de leur parution, nous expliquent que l’immigration est une bénédiction divine, car elle fournit à l’Occident, désormais incapable même de « perpétuer l’espèce », la masse nécessaire au remplacement de la « main d’œuvre manquante ». Ces deux affirmations ne peuvent pas être simultanément vraies, mais c’est là un problème qui n’intéresse plus depuis longtemps cet Occident engourdi, en train de sombrer dans l’oubli de soi le plus complet – car plus rien ne l’intéresse, en-dehors de ses propres parties génitales.
C’est ainsi qu’il s’offre en proie aux masses semi-analphabètes (voire complètement analphabètes) des orients proches et plus lointains, et de l’Afrique : au syrien qui cuit son kesra, au producteur d’héroïne afghan, au berger de chèvres touareg et à ces myriades de terroristes, ou bien « seulement » aux âmes brisées et dévastées par une existence effroyable de pillards, d’assassins, de violeurs, de bons à rien, de parasites sans aucune utilité, que la société d’accueil va devoir entretenir et supporter – acte par lequel l’Occident prend naturellement aussi soin de rendre définitivement impossible la réapparition d’une vie vivable dans cette partie du monde.
Et désormais, on peut aussi considérer comme certain que les nouveaux dirigeants de l’amicale de suicidaires – doublée d’un asile de fous – surnommée « Union européenne » sont maintenant bien résolus à aller jusqu’au bout de l’auto-anéantissement. On vient de rendre public le plan de la commissaire à l’Égalité consacré à son projet de novlangue, proscrivant l’usage de mots comme « Noël » ou « chrétien », des genres féminin et masculin, mais aussi – et là, effectivement, elle innove : par le passé, même les Jacobins et les Bolchéviques n’avaient pas osé ça ! – celui de noms propres comme Marie et Joseph, en lieu et place desquels elle recommande l’usage de Malika et Julio. Rien de nouveau sous le soleil – et pourtant… On prétend que le projet aurait été (provisoirement) retiré du fait de protestations du Vatican. Allons donc ! Ce serait bien la première fois que ces gens-là retireraient quoi que ce soit en raison de protestations du Vatican ! C’était juste la phase de test. Ils ne mettront pas longtemps – soyons-en sûrs – à revenir à la charge.
Mais ce qui est encore bien plus terrifiant, c’est l’avenir de l’Allemagne. Ou plus exactement : son présent. Dans un essai hors du commun, László Bogár écrit que : « L’un des ouvrages de Marx – peut-être le plus cité de tous – est intitulé L’Idéologie allemande. C’est de cet ouvrage que provient – entre autres – la citation qu’on a pudiquement traduite par « le retour des vieilles ordures », alors que le terme-clé qu’elle contient est « un peu plus fort » que le terme « ordures ». Cette fameuse phrase, dans la version originale, est en effet « Die ganze Scheiße kommt zurück », et le mot incriminé est le mot Scheiße. Ce à quoi Marx fait là allusion, c’est l’idée selon laquelle le communisme ne peut pas advenir en tant que « phénomène local », sans quoi le retour de la vieille m..de – qui, pour lui, n’est autre que l’ensemble des résidus encore vivants des traditions sacrales – ferait disparaître ce communisme local. Ce qui, en pure logique, est d’ailleurs strictement vrai, et s’est d’ailleurs produit, quoique selon des modalités qui ne sont pas tout à fait celles que Marx imaginait. Ce qui montre une fois de plus que ce n’est pas le capitalisme dans lequel Marx voyait – comme on pourrait éventuellement le penser – l’incarnation du « mal » dans l’histoire, mais le mode d’organisation de l’existence inspiré par la tradition sacrale. Dans la destruction brutale de cette tradition, il voyait un haut-fait glorieux du capitalisme. Ce qui rime parfaitement avec cette citation, « commise » dans l’un de ses essais philosophiques par le futur chef du super-ministère du climat au sein du nouveau gouvernement allemand, et dont l’exactitude, la capacité « plastique » est sans égale, même dans la littérature de cette Allemagne du XXIe siècle occupée à se noyer de force dans les eaux stagnantes du multiculturalisme : ‘L’amour de la patrie m’a toujours donné envie de vomir. Je n’ai jamais su quoi faire de cette idée d’Allemagne, et je ne le sais toujours pas.’ Voilà ce que, dans un de ses livres, écrivait, il y a un certain temps, Robert Habeck, très populaire vice-président de ces Verts qui viennent d’arriver au zénith de leur popularité – et ceux qui lui imaginent un avenir de chancelier sont de plus en plus nombreux, étant donné qu’il est, juste derrière le futur chancelier social-démocrate, le deuxième homme politique allemand par ordre de popularité. C’est donc ainsi que Habeck, homme appartenant à la deuxième génération d’allemands nés après la guerre, « traduit » pour lui-même et pour ses contemporains, cette sombre et dévastatrice « proposition » – ou, pour être plus précis : les conséquences spirituelles, morales et intellectuelles de cette dernière – que les maîtres « imaginaires » de ce monde ont soumise à ce peuple allemand attiré dans un piège historique fatal par un Troisième Reich dont l’apparition n’avait rien eu d’un hasard. « Cher Peuple allemand, nous te donnons le droit de vivre dans le confort et la sécurité que t’assurent tes propres capacités et ton zèle, mais cette concession est soumise à la condition d’une clause non-modifiable, qui stipule qu’à partir de maintenant, il n’y a ni passé, ni histoire, ni tradition, ni culture. C’est-à-dire à condition que tu « oublies » une bonne fois pour toutes qui tu as été, et qu’au lieu de ton identité millénaire, tu considères comme l’aliment naturel de ton esprit une bouillie multiculturelle cuite à partir d’ingrédients dont la conformité au mondialisme aura été strictement vérifiée. »
Tout cette m…de est donc revenue, quoique pas exactement comme Marx l’avait imaginé, mais justement sous forme de marxisme, de jacobinisme et de bolchévisme. Répétons cette phrase, pour qu’elle s’imprime bien dans notre esprit – voici la confession d’un futur ministre et vice-chancelier de l’Allemagne, Robert Habeck, natif de Lübeck : « L’amour de la patrie m’a toujours donné envie de vomir. Je n’ai jamais su quoi faire de cette idée d’Allemagne, et je ne le sais toujours pas. »
On a compris. Maintenant, tout ce qui nous resterait à comprendre, c’est : de quoi ce taré pourra bien devenir vice-chancelier et ministre. Eh bien, nous lui devrons tout le respect que mérite un vice-chancelier de sa propre envie de vomir. Et, en sa qualité de vice-chancelier et de ministre à la tête d’un super-ministère, aidé de ses camarades, il s’attelle sans attendre à la tâche de rendre l’Allemagne digne de sa propre envie de vomir. Là est le véritable sujet des 175 pages du programme du nouveau gouvernement « allemand » : l’envie de vomir de Robert Habeck. On dirait que les Allemands ont remonté le temps, pour trouver le moment où ils ont fait fausse route. Et qu’ils pensent l’avoir trouvé à l’endroit de la Nuit des longs couteaux. Avec l’idée qu’il aurait peut-être fallu faire ça à l’envers : que les SA liquident les SS, au lieu de se faire liquider par ces derniers – car Ernst Röhm, au moins, était (dit-on) homosexuel. Mais le plus grave, c’est que l’impression qu’ont les Allemands d’être investis d’une mission historique, elle, n’a pas disparu. Et c’est là une impression qui a déjà dévasté le monde à deux reprises. « Deutschland, Deutschland über alles » – chantaient les Allemands conscients de leur mission, tout en dévastant d’abord le monde, puis leur propre pays. « Deutschland, Deutschland unter alles » – voilà ce que chantent aujourd’hui les Allemands conscients de leur mission, sous l’emprise de poussées régulières de cette envie de vomir qui va les amener à dévaster d’abord leur propre pays, puis le monde.
Et nous ? Eh bien, pour nous, la question a atteint un maximum de simplicité : voulons-nous, oui ou non, participer à tout cela ? Voulons-nous nous mettre à parler comme ces authentiques crétins ? Voulons-nous nous mettre à vivre comme ces authentiques crétins ? Voulons-nous commettre un suicide collectif, comme ces authentiques crétins ? A première vue, il ne devrait pas être trop difficile de répondre, mais ne nous précipitons pas. Voyons plutôt ce qu’écrivait László Cs. Szabó sur le dernier européen :
« J’ai appris très tard la nouvelle de la mort du comte Kessler. C’était lui, le « dernier européen », une sorte de duc de Reichstadt dans son genre. Les flots de l’époque roulent encore son nom – plus pour longtemps, je sais. Tout ce qui reste de lui, ce sont des mémoires incomplètes, traduites en français sous le titre : Mémoires d’un Européen, alors même que, dans l’original allemand, il a refusé de se décrire comme un européen.
Le marchand d’art Vollard raconte que ce comte allemand, dans sa jeunesse, faisait fonctionner à Paris une maison d’édition, en amateur. C’est sur ses fonds que Maillol a imprimé les Églogues [autre nom des Bucoliques – n.d.t.] de Virgile. Cela devait être un livre magnifique, illustré et mis en page de la main même du fameux sculpteur – qui a même fabriqué lui-même le papier destiné à l’impression. Or, comme il s’était rendu compte que le traitement au chlore finissait toujours par détériorer même la chiffe de la meilleure qualité, son enthousiaste éditeur fit acheter, dans tous les coins de la lointaine Hongrie, quantité de chemises paysannes qui n’avaient jamais connu le chlore. C’est ainsi que l’une des éditions de Virgile a été imprimée sur du lin hongrois.
Il est un peu attristant de devoir remémorer de telles futilités d’amateur pour évoquer le souvenir du dernier européen. Mais l’Europe est la patrie des patries jalouses, et, perdu entre toutes ces patries, l’homme qui n’est qu’européen a toujours été un amateur. Y compris le plus brillant. Avec l’Europe, on compense un manque de patrie.
Ce n’est pas par hasard que la nation espagnole – un sous-produit mal transformé de la latinité –, dénuée de colonne vertébrale, ait toujours oscillé entre le provincialisme le plus sec et des visions paneuropéennes sans jamais fonder le mode de vie d’une nation enracinée. C’est cette même « greffe » européenne qui a permis à une autre nation périphérique – la nation russe – d’accéder à l’âge adulte de l’esprit : Dostoïevski, déjà, luttait contre cette greffe, et, quoi qu’on en dise, c’est bien là la raison pour laquelle il résiste moins bien à l’épreuve des cent premières années qu’un Pouchkine, ou même qu’un barbare latinisé comme Tourgueniev.
Mais restons-en à l’exemple allemand. Intermédiaire de l’Orient et de l’Occident, de l’Asie et de l’Europe, de l’antique et du barbare, l’Allemand n’a jamais réussi à être suffisamment soi, autant que les trois nations européennes les plus mures : les Italiens, les Français et les Anglais. C’est de cet entre-deux qu’est sorti l’humanisme hors pair des Leibnitz, des Goethe, des Humboldt, des Nietzsche et des Rilke, ainsi que, dans les genres mineurs, ces innombrables allemands qui, jusqu’à leur mort, n’ont jamais su définitivement choisir entre l’épée de l’officier prussien et l’exil volontaire en terres latines.
L’européen est une étoile brillant au firmament, mais qui détonne un peu dans le chœur des nations. Et, là où cette espèce se multiplie au-delà du désirable, elle constitue aussitôt un danger de mort pour la culture nationale. Fils prodigue au pays, exilé de luxe à l’étranger. (Voilà tout ce qu’on peut dire de la mort du comte Kessler.) »
Quant à nous, je propose que nous soyons (que nous restions) des hongrois fiers de l’être et des européens qui s’inquiètent. Après tout, c’est ce que nous avons toujours été. Et, le moment venu, c’est nous qui ferons traverser à notre Europe à nous le fleuve de la pérennité. Avec les réfugiés de l’Allemagne à notre bord. Pour ce qui est du reste… Le reste ne compte pas – pas le moins du monde !
Zsolt Bayer
—
Traduit du hongrois par le Visegrád Post