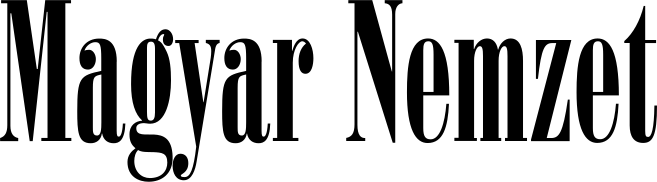Article paru dans le Magyar Nemzet le 2 avril 2022.
Conversation avec le Premier ministre Viktor Orbán
– Monsieur le Premier ministre, d’après mes calculs, cette campagne est la 27ième campagne nationale à laquelle vous participez. Et pourtant, la campagne en cours n’est pas ordinaire du tout. Jusqu’à présent, il n’est en effet pas arrivé que nous nous préparions à aller voter à l’ombre des nuages d’une guerre.
– Aucune campagne n’est identique à aucune autre, car le choix décisif n’a jamais pour objet les candidats ou le chef du gouvernement, mais toujours le pays. Or le pays change en permanence – c’est ce qui fait que chaque campagne est intéressante, et différente des autres. C’est en période de campagne qu’on voit le mieux dans quel état est un pays, et la grande surprise de la campagne en cours, pour moi, c’est qu’en dépit de circonstances peu favorables et de la brutalité de la campagne, la Hongrie est en état de lucidité, et que le regard des Hongrois perce les pires complications de la politique internationale. Ils comprennent parfaitement que ce scrutin est en même temps un choix entre la guerre et la paix : entre se laisser entraîner dans le conflit et savoir rester en-dehors – et ce, tout en aidant les réfugiés ukrainiens à chaque fois qu’ils le peuvent. Bref : ce qu’on voit se dessiner autour de nous, c’est le visage d’une nation adulte, d’un peuple mûr.
– Mercredi, à Pécs, votre adversaire, Péter Márki-Zay, a déclaré que, pour les jeunes, le sang compte plus que le pétrole, et que c’est notre guerre que mène l’Ukraine. Jusqu’ici, on ne peut pas dire que le candidat de la gauche aurait été avare de phrases à faire se dresser les cheveux sur la tête, mais là, il semble avoir atteint un niveau inégalé. Quel est l’objectif de ces provocations ?
– La Hongrie a derrière elle une pandémie, à côté d’elle une guerre et devant elle une économie européenne forcée à une redéfinition complète : ce sont là des circonstances dans lesquelles un dirigeant devrait bien réfléchir à ce qu’il va dire. Les phrases vagues et périlleuses mettent en danger la sécurité et la prévisibilité. Or, s’il y a bien une chose dont on ne puisse pas accuser la gauche dans cette campagne, c’est d’avoir parlé clairement et franchement. A mon avis, la guerre que livrent les Ukrainiens n’est pas notre guerre. Une telle déclaration n’a aucun sens pour une oreille hongroise ; car enfin, ce sont deux énormes pays, deux grands pays slaves qui se font la guerre. La guerre, ce n’est pas une BD de cowboys que ses lecteurs (généralement des adolescents) peuvent feuilleter en s’imaginant dans la peau de tel ou tel des personnages. En politique, une telle attitude représente un danger de mort. Nous devons affirmer haut et fort que cette guerre n’est pas notre guerre, mais une guerre qui nous affecte, car le pays où elle fait rage est un pays voisin, si bien que ce ne sont pas seulement des balles perdues, mais même des opérations militaires planifiées qui risquent de tomber à un jet de pierre de la frontière hongroise. Si, par exemple, des armes étaient livrées vers l’Ukraine, nous pourrions à tout moment nous attendre à des frappes militaires destinées à annihiler ces transports. Nous autres, nous sommes proches des parties en conflit, nous les connaissons bien ; nous, on ne peut pas nous la faire : nous n’avons pas oublié comment les Ukrainiens se sont conduits avec les hongrois de Subcarpatie, et nous savons que ces fantaisies occidentales consistant à s’imaginer l’Ukraine comme une démocratie modèle sont la conséquence d’une totale ignorance du terrain. L’Ukraine est néanmoins devenu un Etat menacé dans son existence même, étant donné que la Russie lui fait la guerre. Il ne fait aucun doute que la responsabilité de cette guerre repose sur les épaules de la Russie, quelles que soient les voies par lesquelles elle est parvenue à la décision d’attaquer. Dans une telle situation, il faut aider ceux qu’a frappé le malheur. Voilà pourquoi nous portons assistance à l’Ukraine, et non parce que la guerre qu’elle mène serait la nôtre. Il existe des pays occidentaux qui souhaiteraient organiser le monde d’après cette guerre sur la base d’une rupture totale entre l’Ouest et l’Est. Si cela devait arriver, ce serait, pour nous Hongrois, et pour l’ensemble de l’Europe centrale, très mauvais. Ce que l’histoire nous enseigne, c’est que, lorsque les grands agrégats de puissance de ce monde sont en conflit et s’isolent les uns des autres, c’est à nous qu’on présente l’addition.
– À votre avis, quelle est la raison qui pousse Péter Márki-Zay à des déclarations de plus en plus dures sur la façon dont la Hongrie se rapporte à cette guerre ?
– Il le fait parce que la gauche veut traîner la Hongrie dans cette guerre. Quand on dit que la guerre que mène l’Ukraine est notre guerre, cela signifie que nous devons tout faire pour qu’elle la gagne : envoyer des soldats, livrer des armes et permettre leur livraison à travers notre territoire. Non seulement qu’on peut le faire, mais qu’il le faut. Il est pour moi certain que la gauche hongroise s’est entendue avec le pouvoir ukrainien : en cas de victoire de la gauche, nous livrerons des armes, la Hongrie fermera les conduites qui acheminent le pétrole et le gaz russes – et tout cela se fera avec l’appui d’un certain nombre de pays occidentaux. Or on ne peut pas donner à cela d’autre nom que : se laisser entraîner dans la guerre.
– Ne craignez-vous pas que cette attitude distante finisse par vous placer en minorité en Europe – voire à vous isoler ?
– Notre position est la position de la majorité : la position de l’OTAN est, à la lettre, celle de la Hongrie. L’OTAN a décidé de rester en-dehors de cette guerre, et nous ne pouvons pas nous engager dans des conflits armés se déroulant au-delà des frontières de l’OTAN. Si une attaque avait visé la Pologne ou les Etats baltes, la situation serait différente. Mais, l’Ukraine n’étant pas membre de l’OTAN, n’ayant pas obtenu de garanties de l’OTAN, nous n’avons pas l’obligation d’entrer en guerre à ses côtés. Au sein de l’UE, la situation est plus compliquée, mais les grands pays – comme l’Allemagne ou la France – professent une opinion proche de la nôtre.
– Au sein du groupe de Visegrád, en revanche, l’alliance a volé en éclats : sur cette question, les quatre sont divisés. Ces dissensions pourront-elles être dépassées ?
– Le fait que ces quatre pays n’ont pas la même politique orientale a toujours placé le V4 devant un défi. Mais le V4 n’est pas un organisme géopolitique ; il n’a pas été créé à des fins géopolitiques, mais de façon à nous permettre, dans le cadre des débats au sein de l’UE, de défendre d’une seule voix les intérêts de l’Europe centrale – qu’il s’agisse de problèmes économiques ou de questions touchant aux valeurs. Le V4 continuera donc à l’avenir à accomplir sa mission initiale : dans ces domaines, nous n’avons pas de divergences de vues.
– Nous sommes passés sans transition d’une épidémie à une guerre, et nous voici déjà, sans attendre, face à une crise économique. En période de campagne, peut-on encore trouver le temps de faire quoi que ce soit pour y remédier ?
– Le ciel est menaçant, c’est certain. Si le temps était plus ensoleillé, la gauche aurait de meilleures chances de l’emporter, car, dans la mentalité hongroise, lorsque les soucis pointent le bout de leur nez, on préfère laisser la barre au camp national. Et en effet, la Hongrie va maintenant avoir besoin de nous. C’est pourquoi je vous encourage toutes et tous à voter pour l’alliance Fidesz–KDNP, car nous allons avoir besoin d’un gouvernement expérimenté, calme et imperturbablement fidèle aux intérêts de la nation. En ce qui concerne la situation économique, le plus alarmant, c’est que les chiffres allemands de l’inflation ont dépassé les sept pour cent, et on ne peut même pas exclure qu’ils finissent par dépasser les dix pour cent. Or l’Allemagne est le pays-clé dans l’Union européenne, et l’économie hongroise est de mille manières différentes liée à l’économie allemande. L’autre grand souci, c’est que toutes ces crises hétérogènes commencent à se combiner : l’inflation, la guerre, la dette des pays du Sud de l’Union et la politique énergétique de Bruxelles, dont le principe est, au nom d’objectifs climatiques, d’augmenter constamment, de façon préméditée, le prix des sources d’énergie classiques. En temps de guerre, une telle stratégie est suicidaire. Nous devons forcer Bruxelles à suspendre cet exercice.
– Ce que tout le monde ressent d’ores et déjà, ce sont les hausses de prix. Peut-on y faire quoi que ce soit ?
– En Hongrie, nous aurions au moins trois points d’inflation de plus sans les mesures par lesquelles l’Etat empêche le prix de certains produits d’augmenter, par la contrainte. On peut donc dire que nous avons d’ores et déjà agi contre les hausses de prix, et que nous continuons à défendre les familles, mais que, seule, la Hongrie ne pourra pas faire face au problème. C’est à l’échelle européenne que nous avons besoin d’une politique anti-inflationniste décidée, visant avant tout à maintenir au plus bas les prix de l’énergie. Et pendant ce temps, nous ne devons pas perdre Berlin des yeux, et regarder comment l’Allemagne affronte sa propre inflation, car si eux n’y arrivent pas, pour nous aussi, ce sera très difficile.
– La gauche affirme qu’à moins qu’elle gagne, Bruxelles ne nous enverra pas d’argent. Est-ce vrai ?
– Au moment où nous parlons, les transferts en provenance de Bruxelles ont lieu, aujourd’hui comme hier, quotidiennement. Le budget que nous avons adopté en commun est appliqué à la lettre, les sommes qui nous sont allouées arrivent en permanence, et il s’agit de centaines de milliards de forints [100 milliards de forints = 270 millions d’euros – n.d.t.]. Nous avons même soumis à la Commission une proposition dont l’effet doit être d’assouplir les règles d’utilisation de ces fonds. Les sept ans du prochain budget pluriannuel commençant en décembre, c’est à ce moment qu’on peut s’attendre à ce qu’un accord soit passé entre la Hongrie et l’Union. Il y a aussi un troisième facteur : le fonds de relance mis en place en raison de la pandémie, à l’origine de transferts que 4 pays sur 27 – dont la Hongrie – n’ont pas encore touchés. Des négociations sont en cours, et, pour autant que je puisse en juger, Bruxelles joue la montre, dans l’espoir que la Hongrie va se doter d’un gouvernement de gauche, à qui l’UE réussirait à faire accepter des conditions qu’un gouvernement du camp national ne pourrait que refuser. Mais il est hors de doute que, à condition de gagner ces élections, nous réussissions à mettre rapidement un terme à cette controverse, comme à d’autres.
– La gauche a, les unes après les autres, rejeté toutes les mesures les plus fondamentales de la gestion de crise choisie par votre gouvernement. Par ailleurs, elle a remis au goût du jour un mot qu’on était sur le point d’oublier : la rigueur. Elle prétend que c’est ce que le Fidesz compte mettre en place. Est-ce le cas ?
– Non seulement ils ont voté contre nos mesures, mais ils les attaquent même en permanence. Le meilleur exemple est celui de notre politique de réduction des factures. Or comment ceux qui souhaitent se priver du gaz et du pétrole russe – comme ils affirment vouloir le faire – pourraient-ils conserver une telle politique ? C’est impossible. Parmi les mesures contre lesquelles ils ont voté et qu’ils ont critiquées depuis le tout début, il y a notre système d’aide aux familles, d’aides au logement, et tout ce qui fournit aujourd’hui à l’économie hongroise une assise stable. Il est bien évident qu’eux s’empresseraient de démolir ces fondements, comme ils l’avaient fait après 2002. Le résultat est bien connu de tous : un effondrement complet, suivi, au bout de quelques années, d’un risque de faillite d’Etat. En ce qui concerne la rigueur, c’est l’instrument de gestion de crise que la gauche a toujours préféré : c’est son étoile polaire. Nous, nous préférons faire face aux crises par la méthode opposée : créer des emplois et baisser les impôts.
– Dans vos discours, quand il est question de la gauche, vous affirmez souvent qu’elle n’a en rien changé. Et pourtant, elle a changé : n’est-il pas curieux de constater à quel point, ces derniers temps, elle est devenue tolérante à l’égard des propos antisémites et des saluts nazis ?
– C’est là, pour ses sponsors occidentaux aussi, une source d’inquiétudes majeure : le fait que la gauche hongroise ait conclu une alliance avec l’extrême-droite. C’est une situation sans précédent. Pour ma part, j’ajoute cela à la liste des péchés historiques de la gauche. Alors même qu’aujourd’hui, la Hongrie vit une époque de paix et de réussites et que la chose publique se porte bien – mais il n’est pas certain qu’il en sera toujours ainsi. Et si une crise s’abat sur nous, et qu’on laisse les idées extrémistes se frayer un chemin vers les territoires de l’expression politique licite, on risque de voir apparaître des théories qui, dans ce pays, ont déjà causé bien des tragédies. Or c’est bien là ce que la gauche vient de faire, et une fois que l’inondation est déjà là, il sera trop tard pour réparer les digues.
– Après trois défaites consécutives, cette fois, la gauche a réussi à s’unir, de façon à faire front contre le Fidesz. Cet ordre de bataille vous inspire-t-il des inquiétudes ?
– Non. Ils ont risqué le tout pour le tout, et dimanche, ils vont tout perdre. Des programmes incompatibles entre eux, des systèmes de valeurs impossibles à concilier, des cultures mutuellement exclusives, des partis qui se considéraient jadis les uns les autres comme des ennemis à vaincre – ou même comme des ennemis à annihiler : voilà ce qu’ils ont réussi à regrouper sous un même drapeau, sous le signe de la capitulation de toute morale. Or, pour quelque communauté politique que ce soit, il n’existe pas de plus grand danger que celui de perdre son identité. La seule chose qui pourrait rendre acceptable ce coup de poker politique, c’est la victoire. Mais si personne ne fait défaut, dimanche, la victoire sera à nous.
– Ne pensez-vous pas que le sujet du référendum sur la protection de l’enfance, lui aussi, pâlit un peu à l’ombre de ces nuages de guerre ?
– À chaque réunion de campagne, je m’efforce de rappeler au public l’importance de ce référendum. En Occident, ce qui avait commencé sous la forme d’une mode étrange est entre-temps devenu une exigence politique : l’obligation d’accepter, et même de promouvoir les conceptions de la famille qui s’écartent de la nôtre. Là-bas, on en est arrivé au point où, en refusant de promouvoir activement les modèles familiaux qui s’écartent du modèle traditionnel chrétien, on s’expose à une stigmatisation. Ce que nous affirmons – que le père est un homme, la mère une femme, et qu’il faut laisser nos enfants tranquilles –, en Occident, ce sont d’ores et déjà des opinions indicibles, et les soutenir en public vous expose même à perdre votre emploi. Et pourtant, quand tout cela a commencé, cela semblait encore inoffensif : « soyons tolérants à l’égard de ceux qui choisissent un mode de vie différent du nôtre ». Ce qui est d’ailleurs légitime : dans les limites de la loi, les adultes font ce qu’ils veulent de leur vie. Néanmoins, l’objet du référendum, ce ne sont pas eux, mais les enfants. Car eux, en revanche, il faut les protéger de ces modes aberrantes, et empêcher qu’à un âge qui les rend de toute façon sensibles, des enfants ne soient atteints par des influences que leurs parents n’approuveraient pas. La responsabilité de l’éducation des enfants incombe prioritairement aux parents : ce sont donc autant leurs droits que ceux des enfants que ce référendum entend protéger. Tout cela est bien plus important que certains ne pourraient le penser, car cette pression politique et idéologique que recouvre le terme de « genre » avance d’ouest en est, de façon presque irrépressible. Or il nous est possible, moyennant un référendum, d’opposer une digue à cette inondation.
– Quel sera l’enjeu des élections de dimanche ?
– La guerre ou la paix. Ceux qui veulent la paix auront tout intérêt à voter pour le camp national ; ceux qui veulent la guerre n’auront qu’à soutenir la gauche.
Péter Csermely
—
Traduit du hongrois par le Visegrád Post