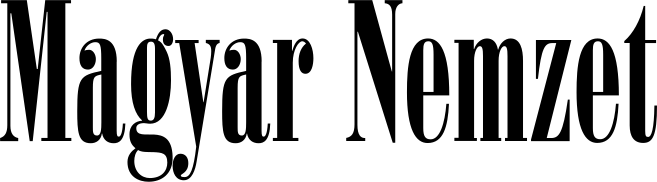Sous la présidence de Joe Biden, s’opposer à la tyrannie de la gauche libérale ne sera pas une partie de plaisir
Dans les débats idéologiques, la gauche aime bien prendre le dessus en taxant ses adversaires – et en général ceux qui ne lui plaisent pas – d’antisémitisme ou de racisme. L’ennui, c’est que cela conduit à démonétiser ces expressions – affirme David Reaboi, citoyen américain né aux États-Unis, mais très fier de ses ancêtres juifs transylvains, que l’ambassade hongroise de Washington a chargé, en septembre dernier, d’y représenter les intérêts de la Hongrie. Dans l’interview qu’il donne à Magyar Nemzet, cet expert en sécurité nationale, décrit par la revue Politico comme un « twito-pugiliste de droite » – et qui se trouve diriger aussi le cabinet de communication Strategic Improvisation – nous explique, entre autres, que la présidence de Joe Biden ne sera pas une partie de plaisir pour ceux des pays qui hésiteraient à se soumettre à la tyrannie de Démocrates plongés dans l’aveuglement idéologique de la gauche libérale, portant l’immigration aux nues et encourageant l’activisme agressif des communautés LGBT.
Magyar Nemzet – Plusieurs organes de la presse hongroise ont déjà rapporté qu’en septembre dernier, l’ambassade de Hongrie à Washington a passé contrat avec vous. Concrètement, de quelles missions avez-vous été chargé ?
David Reaboi – Comme le contrat est consultable en ligne dans son intégralité, et que la presse hongroise de gauche libérale l’a déjà décortiqué par le menu, j’ai un peu peur d’ennuyer le lecteur. Mais disons que ma mission est, pour l’essentiel, de tracer une voie en vue de lui trouver de nouveaux amis parmi les conservateurs américains. En dépit de la taille relativement modeste de la Hongrie, les médias les plus suivis de la planète lui consacrent souvent des sujets – inutile de dire que ces comptes-rendus reproduisent presque tous un récit négatif, méticuleusement mis au point, et répété jusqu’à la nausée. Être dans la ligne de mire de la haine des médias, c’est une chose ; la réaction des gens face à ces campagnes, c’est une tout autre chose. L’observateur extérieur, en effet, voit souvent la Hongrie comme un pays en première ligne du conflit qui oppose mondialisme et nationalisme, or de nombreux américains aimeraient bien prendre la voie qu’a pavée le gouvernement hongrois au cours de ces dernières années. En l’occurrence, je pense notamment à sa politique familiale, à sa politique de l’immigration et à ses tentatives d’engager un combat contre les réseaux abstraits des ONG, c’est-à-dire contre George Soros. Le gouvernement hongrois défend des valeurs qui ont la sympathie de beaucoup de gens, et ces gens seraient encore plus nombreux, si l’opinion n’était pas en permanence confrontée à l’image de la Hongrie construite par le monopole médiatique de la gauche libérale : une image lourde de malentendus et de distorsions. Ma mission consiste à y remédier.
MN– Parmi les reproches adressés à la Hongrie sur la scène internationale, celui d’antisémitisme revient fréquemment. Vous-même êtes particulièrement fier de vos ancêtres juifs de Transylvanie et de votre passé familial enraciné dans la culture hongroise. Comment réagissez-vous, donc, à ce genre de critiques ?
DR – En un mot comme en cent : je les considère comme d’énormes imbécillités. Par contre, je peux parfaitement comprendre que les Hongrois puissent s’enfoncer dans une certaine confusion devant les avalanches de critiques que déversent sur eux les réseaux d’ONG financées par George Soros, et les médias de gauche libérale acquis à l’idéologie de ces derniers, et lui fournissant en permanence leurs premières pages et l’attention de millions de lecteurs et d’auditeurs. Moi, en revanche, en tant que juif qui a combattu l’antisémitisme tout sa vie,j’ai une toute autre lecture de la Hongrie, et notamment du rapport du gouvernement hongrois à la culture juive.
MN– Mais pourquoi ce reproche nous est-il resservi encore et encore, s’il est dénué de tout fondement ?
DR – Quand il faut mettre en accusation un leader ou un gouvernement de droite du point de vue idéologique, il faut s’attendre à voir la gauche libérale tirer presque aussitôt de sa manche la carte de l’antisémitisme, et/ou celle du racisme. En Europe, on considère que coller à autrui l’étiquette « antisémite », c’est le sommet de l’arsenal dissuasif, alors qu’en Amérique, la même position est occupée par l’étiquette « raciste ». Or dans les débats idéologiques, la gauche aime bien prendre le dessus en taxant ses adversaires – et en général ceux qui ne lui plaisent pas – d’antisémitisme ou de racisme. L’ennui, c’est que cela conduit à démonétiser ces expressions. Aujourd’hui, nous en sommes arrivés au point où les actes véritablement antisémites n’impressionnent plus vraiment. Or cette banalisation de l’antisémitisme fait entrer dans le domaine du frivole un concept qui a été à l’origine de souffrances indicibles, non seulement pour ma famille à moi, mais aussi pour des millions d’autres personnes. Pour ne rien dire du fait que ces mêmes voix, si sonores quand il s’agit de taxer d’antisémitisme le gouvernement hongrois, participent à un lobbying tout aussi bruyant et résolu contre l’inscription à la liste des organisations terroristes d’un Hamas pourtant copain comme cochon avec le Hezbollah. Prendre la défense d’une organisation palestinienne de l’Islam radical, ce n’est pas de l’antisémitisme. Alors même que le Hamas ne fait absolument pas mystère de son antisémitisme. A les en croire, en revanche, les antisémites, ce seraient plutôt les Hongrois, ou du moins, le gouvernement hongrois. Ai-je bien entendu ?
MN– Vous avez, par le passé, travaillé pour l’administration Trump, si bien qu’encore aujourd’hui, on vous taxe souvent d’être un « trumpiste », ou encore d’appartenir à l’« alt right ». Dans l’Amérique du quotidien, sont-ce là des stigmates négatifs ?
DR – Erreur : je n’ai jamais travaillé pour l’administration Trump, même si je sais bien que, ces derniers temps, je suis dans la ligne de mire de médias – principalement de gauche libérale – qui répandent ce genre de bruits.C’est du délire pur et simple ; je ne serais pas étonné d’apprendre qu’au cours d’investigations journalistiques menées sur mon parcours, tel ou tel élément ait été mésinterprété. Il est vrai qu’en 2017, ils ont publié quelques articles dans lesquels j’étais mentionné avec des qualificatifs de ce genre : j’aurais prodigué des conseils en matière de sécurité nationale à l’administration Trump, mais c’est là une tout autre question. J’ai travaillé pour un think tank au sein duquel j’étais l’un des trente à quarante conseillers qui fournissaient au gouvernement des conseils afférents à divers problèmes de sécurité nationale. Mais bien entendu, ces articles à charge ne prenaient pas grand soin de fournir sur moi des informations exactes – alors même que la vérification de telles informations constitue l’une des tâches les plus simples au monde : il suffit d’aller sur le site de la Maison Blanche, où se trouve le nom de tous ceux qui, à n’importe quel moment du passé ou du présent, y ont travaillé. Et le mien ne s’y trouve pas.
MN– Et cette étiquette de « trumpiste » ?
DR – Celle-là ne me pose aucun problème : j’ai bel et bien soutenu Donald Trump, et continue à le soutenir ; je considère qu’il a été un président formidable, et ce, tout particulièrement dans le domaine de la politique étrangère. En tant qu’expert en sécurité nationale, je pense que, depuis Ronald Reagan, l’Amérique n’avait pas eu un chef aussi remarquable – même si, bien entendu, il est difficile de comparer ces deux présidences, dans la mesure où les défis auxquels l’un et l’autre ont été confrontés sont très différents ; et pourtant, l’un et l’autre ont supporté avec brio l’épreuve d’époques hors du commun. Bien sûr, je comprends votre question, et je ne cherche pas à m’y dérober, mais j’aimerais commencer mon explication un peu en amont. Dans les années 1970, le New York Times avait une critique de films extrêmement célèbre, Pauline Kael. En 1972, quand un tsunami électoral sans précédent dans l’histoire américaine a porté Richard Nixon au pouvoir, Kaela écrit : j’ai du mal à croire que Nixon ait gagné, étant donné que je ne connais personne qui ait voté pour lui. Depuis lors, cette phrase est devenue proverbiale dans la politique américaine, car elle montre bien le délire du monde médiatique, à savoir : à quel point l’élite des formateurs d’opinion de la gauche libérale est incapable d’apercevoir quoi que ce soit au-delà des bornes de l’univers qu’elle s’est elle-même forgé. Mais dès qu’on quitte cette bulle médiatique aux couleurs de l’arc-en-ciel, on voit que tout n’est pas perdu. Il y a, bien sûr, des « États bleus » dans lesquels, si j’affichais tel ou tel symbole trumpiste au fronton de ma maison, cette dernière serait – littéralement – incendiée, mais la société américaine est beaucoup plus hétérogène que les médias ne veulent bien le faire croire. C’est ce que démontre, en autres, le résultat très serré des élections présidentielles de novembre dernier. En 2016, certes, la situation était différente – disons qu’il était plus problématique d’être un partisan de Trump. Mais quatre ans ont passé, et pendant ces quatre ans, les gens ont eu le temps de voir que la situation économique s’est beaucoup améliorée – elle n’a jamais été aussi bonne –, que le chômage avait beaucoup régressé – il y a très longtempsqu’il n’avait pas été aussi bas –, que ces guerres interminables se sont arrêtées, et je pourrais continuer la liste. Qui plus est, Trump a réussi à résister à l’hégémonie de l’extrême-gauche ; face aux usines à fake news, il a appelé un chat un chat, il a prouvé son patriotisme, et les gens ont apprécié tout cela.
MN– A quoi la Hongrie doit-elle s’attendre ? Que nous réserve la présidence de Joe Biden ?
DR – Plusieurs pays du monde sont dans une situation semblable : ceux qui ont un gouvernement de droite, et/ou ceux où la société reste encore majoritairement attachée aux valeurs traditionnelles. C’est un conflit que les analystes politiques décrivent en général comme un débat opposant le mondialisme au nationalisme, mais, à mon avis, cette présentation ne rend pas vraiment compte de la réalité dont il est ici question. Un bon ami à moi, qui a par le passé travaillé à la Maison Blanche, a appelé ça « la tyrannie bleue ». C’est une conceptualisation qu’il est difficile d’interpréter en-dehors du cadre culturel des Etats-Unis, où tout le monde associe la couleur bleue aux Démocrates, mais la théorie en elle-même est d’une portée qui dépasse de loin les frontières de l’Amérique. Prenons l’exemple du Brésil, et de son président clairement positionné à droite, Jair Bolsonaro, ou d’Israël sous un Benjamin Netanyahou lui aussi bien à droite – mais on pourrait aussi ajouter la Pologne à cette liste. Tous ces pays nagent contre le courant, en s’opposant à ces forces internationales de la gauche qui portent aux nues l’immigration et l’activisme agressif des communautés LGBT. Leur arme favorite contre ces pays est celle des accusations liées à l’état de droit. Quant à la « tyrannie bleue », elle s’enfonce peu à peu dans un acharnement pathologique au service de ses propres idéaux, refusant de plus en plus de tolérer l’existence d’opinions divergentes ou de visions du monde autres que la sienne, vivant dans un aveuglement idéologique qui finit presque par ressembler à un fondamentalisme religieux. Il est certain que la présidence Biden ne va pas être une partie de plaisir pour ces pays refusant de se soumettre à la « tyrannie bleue ».
Loretta TÓTH