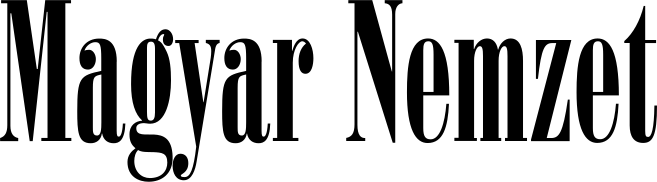Article paru dans le Magyar Nemzet le 24 février 2021.
Zalán Bognár : Malheureusement, ce trauma historique de notre nation est toujours absent des livres d’histoire
« S’il fallait caractériser la déportation des civils hongrois du point de vue de ses conséquences, le seul nom qu’on pourrait lui donner est : déportation en vue de travaux forcés débouchant sur une mortalité de masse » – déclare l’historien Zalán Bognár, président de l’Association Internationale des Chercheurs spécialisés dans l’étude du Goulag et du GUPVI. Il nous parle de la conférence organisée à partir de demain par cette association, de la respectabilisation rétrospective du communisme au XXIe siècle, et de l’apport informatif des sept cent mille fiches récemment numérisées.
– Cela fait maintenant trente ans que vous étudiez l’histoire des gens déportés dans les camps du Goulag et du GUPVI. N’est-ce pas pénible, d’étudier un sujet pareil, d’assister à longueur de vie à ces innombrables tragédies humaines ?
– C’est vrai que c’est très différent, de travailler sur un sujet dont les effets sont encore sensibles, sur une époque qui est encore vivante en nous – même si pour beaucoup ce n’est plus le cas qu’au niveau de l’inconscient collectif. Car pour beaucoup d’entre nous, pour une moitié, ou au moins un tiers de notre peuple – et j’en fais partie –, ce sujet touche aussi à notre histoire personnelle : mon grand-père a aussi fait partie de ces déportés innocents, jamais condamnés par aucun tribunal – raflé pour sa part à Budapest, sous prétexte de vérification de son identité. Lui, Dieu merci, fait partie de ceux qui ont réussi à en revenir, même s’il ne pesait plus que 38 kilos à son retour, et malheureusement, il est mort peu après, si bien que moi, je n’ai plus eu la chance de le connaître. Lors de mes cours en université et de mes conférences en province, ce que je ressens, c’est que notre société a un grand besoin de clarification de cette partie de notre histoire pleine de souffrances, longtemps occultée, condamnée à l’oubli.
– Les tabous ont cédé ? Les victimes commencent à parler ?
– Ils sont de plus en plus nombreux à prendre contact avec moi ou avec notre association, l’Association Internationale des Chercheurs spécialisés dans l’étude du Goulag et du GUPVI, pour nous demander de les aider à reconstituer le destin d’un parent ou d’un proche, de grands-parents ou d’arrière-grands-parents, le lieu de leur décès ou tout autre information qu’il reste possible de trouver sur tel ou tel de leurs ascendants qui a été du nombre des civils déportés, ou qui s’est retrouvé prisonnier de guerre. J’ai reçu de très nombreux remerciements pour avoir consacré des livres à ce thème, provenant de ceux à qui ces livres ont donné l’impression qu’enfin quelqu’un révélait au monde l’histoire de leur père, de leur mère, de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, que le destin d’un être cher déporté en qualité de civil innocent vers les travaux forcés ne va pas sombrer dans les ténèbres de l’oubli. Et ces rencontres personnelles sont pour moi une grande source de motivation en vue de la poursuite de mes recherches.
– Y aurait-il tel ou tel de ces destins qui vous aurait tout particulièrement ému ?
– Il y en a plusieurs, qui se sont profondément gravés dans ma mémoire. Par exemple l’histoire d’une famille qui vivait dans un hameau de Petite Coumanie (Kiskunság). Des soldats soviétiques ivres sont arrivé dans leur hameau et ont réclamé des femmes. La famille avait cinq filles, entre 8 et 21 ans.
L’un des soldats a violé l’une des filles, nommée Júlia, qui avait 19 ans, sous les yeux de toute la famille. Un des frères de la fille, perdant tout contrôle de soi, a tué le soldat au moyen de l’arme que ce dernier avait laissé traîner, amenant les deux autres soldats à prendre la fuite. La fille violée et son frère ont été torturés à mort, les parents, en qualité de dirigeants d’une « bande terroriste », ont été condamnés à mort, tandis que tous les autres membres de la famille qui avaient plus de 12 ans, ainsi que le mari de la fille aînée – également présent au moment des faits –, ont écopé de peines allant de 15 à 25 ans de travaux forcés.
La petite Erzsébet, alors âgée de huit ans, a donc grandi comme une orpheline ; ce n’est que onze ans plus tard, en 1956, qu’elle a pu retrouver ses trois sœurs survivantes.
– Cela fait plus ou moins trente ans qu’il est permis de commémorer les déportés. Depuis le changement de régime, à votre avis, dans quelle mesure la société hongroise s’est-elle familiarisée avec ce sujet ?
– A l’époque communiste, il était malheureusement impossible d’en parler – un interdit dont, même aujourd’hui, les répercussions restent très sensibles, étant donné que des générations entières ont grandi dans l’ignorance de ces faits historiques. L’occultation des faits historiques et l’accumulation des mensonges serinés tout au long de 45 années ont doté une grande partie de la population d’une vision du monde distordue et falsifiée, à laquelle il est très difficile de remédier. Comme István Örkény – qui avait lui-même parcouru les camps de prisonniers soviétiques dans le cadre du service du travail obligatoire – l’avait dit en 1956 sur Radio Kossuth, dans un exercice d’autocritique : « Nous avons menti la nuit, nous avons menti le jour, nous avons menti sur toutes les fréquences possibles et imaginables. » C’est d’ailleurs à cet aveu qu’il a dû l’interdiction de publier qui l’a frappé pendant cinq ans.
Malheureusement, ce trauma historique de notre nation est toujours absent des livres d’histoire : soit ils l’ignorent complètement, soit ils consacrent une seule et unique phrase à sa reconnaissance – mais même dans ce cas, leur présentation ne correspond pas toujours à la réalité historique.
Et bien entendu, les marxistes ne sont jamais contents qu’on pointe l’inhumanité de régimes basés sur les principes de Marx.
– Que pensez-vous du fait qu’en Occident, on réhabilite actuellement le communisme ? L’Allemagne a récemment inauguré des statues de Marx et de Lénine.
– J’en vois la cause principale dans le fait – déjà évoqué – qu’à l’instar de la Hongrie, tout le bloc communiste a pratiqué en permanence, tout au long de 45 années, le formatage des consciences, le mensonge, la falsification de l’histoire, l’occultation et le lavage de cerveau. S’y ajoute le fait que pour beaucoup, le changement de régime a signifié une sorte de réduction du niveau de vie, une sorte de monde devenu profondément incertain – par rapport aux eaux stagnantes des régimes paternalistes de l’époque communiste. Ce qui fait qu’ils repensent avec nostalgie à l’époque du communisme, qui limitait certes beaucoup leurs libertés, mais leur donnait de la sécurité, et une certaine égalité – même si c’était l’égalité dans la pauvreté. N’oublions pas que les dictatures communistes ont, pour la plupart, commencé à mollir avant le changement de régime. Si elles avaient été balayées par une vague révolutionnaire après la mort de Staline, les gens n’auraient pas oublié l’inhumanité du régime, ni ses horreurs, et n’éprouveraient aucune nostalgie du communisme.
Outre le manque de connaissances, il y a un autre facteur important poussant les gens vers la gauche : la prédation avide des multinationales, contre laquelle les gouvernements soit ne veulent pas, soit ne peuvent pas agir dans l’intérêt des citoyens.
C’est pourquoi il se tournent vers une vision du monde utopique, qu’ils croient trouver dans le marxisme-léninisme, alors même que l’histoire mondiale a administré la preuve sans appel du fait qu’aucun régime empreint d’humanité ne peut être créé sur les fondations du marxisme-léninisme.
– Au printemps 2021, les Archives Nationales Hongroises ont prévu de mettre en ligne la base de données de presque sept-cent mille noms sur laquelle vous venez de travailler pendant deux ans. Que représente cet événement du point de vue de la recherche ?
– C’est un projet qui nous ouvre d’immenses possibilités, car sur chacune de ces presque sept-cent mille fiches individuelles, il y a 18 questions, dont certaines avec trois sous-questions, plus d’autres informations, comme le numéro du camp où la fiche a été complétée. Ce qui signifie qu’en tout, sur ces fiches, il y a plus de 13,5 millions de données ! On s’est en outre rendu compte que ce fonds ne contient pas uniquement des fiches initialement complétées dans les camps du GUPVI (Direction Générale des Prisonniers de guerre et des Internés), mais aussi d’autres provenant de camps du GULAG (Direction Générale des Camps de rééducation). Il faut cependant ajouter que ces quelques sept-cent mille fiches ne contiennent que les noms de ceux qui, survivant au voyage, sont parvenus à l’un ou l’autre des camps de l’Union Soviétique.
En revanche, les noms des quelques deux cent mille déportés libérés plus tard par les camps situés dans le Bassin des Carpates, en Europe centrale ou du Sud-est ne s’y trouvent pas, pas plus que ceux des 100 à 120 milliers de déportés qui sont morts dans ces derniers, ou au cours de transports ferroviaires.
Mais dans les fiches, d’une part, il manque aussi beaucoup de noms de déportés qui sont bel et bien arrivés dans les camps soviétiques, d’autre part, il peut au contraire arriver qu’une même personne figure sur plusieurs fiches.
– Le titre de votre conférence est : Communauté et individu dans le contexte des déportations en Union Soviétique. Comptez-vous placer l’accent sur les parcours biographiques individuels ? En parcourant la liste des sujets, je vois que les exposés rendront surtout compte de recherches régionales et locales, menées en province.
– Après un examen de la société hongroise dans son ensemble, nous passons aux petites communautés et aux groupes sociaux de plus petite taille, pour finalement en arriver aux destins individuels. La première section sera consacrée à l’extraordinaire importance qu’a eu en Hongrie et en Transylvanie la question dite « des prisonniers (de guerre) » au cours des années suivant la fin de la Guerre Mondiale. C’est aussi dans cette section qu’on abordera les informations obtenues jusqu’à présent par l’étude de cette base de données de presque sept-cent mille fiches. Ce sont en tout trois exposés qui présenteront de très nombreuses données, de nombreux faits bruts et complexes qui sont encore inédits, concernant la société hongroise tout entière. Divers exposés présenteront les résultats, riches en nouveautés très intéressantes, d’études menées sur le sort de groupes régionaux ou catégoriels : des sondages en profondeur menés à l’échelle de l’arrondissement ou de l’agglomération, mettant bien entendu aussi à jour des destins individuels extraordinaires et étonnants – de ces destins dont l’accumulation finit par constituer l’histoire. Il est ici important de rappeler aussi que la période d’étude sur laquelle porte cette conférence termine en 1956 – pour diverses raisons, mais avant tout parce que 1956 a vu une nouvelle vague de déportation de citoyens hongrois en Union Soviétique…
– « Comme les communistes ont fait disparaître les sources documentaires, les souvenirs personnels sont importants. On peut donc dire que ce domaine de recherche en est encore à ses débuts. Beaucoup de questions restent encore sans réponse – sachant que, si l’on inclut les parents et les proches des déportés dans le calcul, ces événements ont affecté plus de quatre millions de personnes. » – ce sont les propos que vous avez tenus dans un entretien donnée à Magyar Nemzet.
– Oui, c’est précisément du fait de ce grand nombre des concernés dans la société contemporaine qu’il serait d’une grande importance d’enfin créer un Institut de Documentation et de Recherche sur le Goulag et le GUPVI, ou tout du moins un groupe de recherche au sein de tel ou tel institut déjà existant, où les recherches, parallèlement au traitement de cette quantité colossale de données, s’occuperaient de collecter les sources écrites et audiovisuelles encore accessibles et les études disponibles à ce sujet ; un tel centre fonctionnerait aussi comme une administration publique, en charge de la délivrance de certificats concernant les déportations en Union Soviétique.
– Il n’est donc pas facile de dépouiller la paperasse produite par la bureaucratie soviétique.
– Le personnel des Archives Nationales Hongroises a réalisé un travail colossal, mais le plus gros est encore à venir : les erreurs de rédaction et les lacunes informatives sont innombrables. Il faut imaginer la situation, dans laquelle un secrétaire d’origine ouzbèke, lettone, kazakhe ou autre doit noter en russe les informations qui lui sont oralement communiquées en hongrois. Les cas dans lesquels ils ont mal entendu, écrit ou traduit de travers sont légion, et ces cas ne sont pour la plupart pas repérables au moyen d’algorithmes, mais rendent nécessaire l’emploi de moyens humains. Il faudrait de plus comparer ces données à celles des sources hongroises – banques de données ou archives –, et, bien entendu, synthétiser tout cela ! Mais pour ce faire, il faudrait disposer d’un institut indépendant, ou au moins d’un groupe de recherche. Le traitement de ces données permettrait d’apporter à plusieurs centaines de milliers de familles un minimum de compensation morale, sous la forme d’informations sur les circonstances oubliées ou tues de la vie et de la mort de leurs êtres chers.
– Après avoir déterminé le taux de mortalité et l’origine des déportés, peut-on encore nommer « travail obligatoire » (notion à laquelle renvoie l’expression pseudo-russe málenkij robot, par laquelle les Hongrois y font le plus souvent référence) ce phénomène historique ? Ne serait-il pas plus exact de parler d’une forme de punition collective ?
– C’est une question que beaucoup ont déjà soulevée ; en effet, l’expression málenkij robot (« petit travail ») est à première vue trompeuse. C’est une expression que la science historiographique a empruntée à l’usage populaire. Dans le souci d’un usage plus correct, nous autres, historiens, la plaçons entre guillemets, pour au moins deux raisons. D’une part, parce que l’expression provient de l’excuse fallacieuse employée par les soldats soviétiques eux-mêmes pour tromper leurs victimes – des centaines de milliers de civils – lors de ces enlèvements ; naturellement, la forme russe correcte serait malenkaya rabota, mais il faut dire que ceux des soldats soviétiques qui n’étaient pas ethniquement russes (ou au moins slaves) savaient à peine le russe, et devaient donc eux-mêmes mal prononcer cette expression – à quoi s’ajoutait la mésinterprétation des prisonniers hongrois, le tout débouchant sur cette forme apocopée encore en usage chez nous. L’autre raison que nous avons d’employer les guillemets est que nos concitoyens civils victimes innocentes de l’opération n’étaient justement pas emmenés pour l’effectuation d’un petit travail, mais au contraire vers de longues années de travaux forcés. Et pourtant, au début, dans les documents officiels de l’époque, ces enlèvements sont bien désignés comme des déportations.
Une lettre signée par József Révai, idéologue en chef du Parti Communiste Hongrois, nous apprend même que de nombreux membres de la gauche hongroise – dont le ministre de l’Intérieur Ferenc Erdei, ancien secrétaire général du Parti National Paysan (mais en parallèle aussi secrètement membre du Parti communiste) – comparaient les enlèvements soviétiques à la déportation des Juifs par l’Allemagne nazie.
– Cette comparaison est-elle correcte ?
– Les méthodes de déportation étaient effectivement comparables ; cependant, le but des camps soviétiques du GUPVI n’était pas d’exterminer les détenus, mais de les faire travailler. Il est vrai que, dans de nombreux cas, ce travail forcé les a fait mourir. Un tiers des prisonniers du GUPVI a succombé au manque d’hygiène qui caractérisait ces camps, au manque de nourriture, aux épidémies de typhus et de dysenterie et au surmenage. Mais il y a aussi des cas comme ceux des villages de Beregdaróc ou de Tabajd : les conditions de vie inhumaines des camps ont fait périr 90% des déportés de ces villages.
Par conséquent, s’il fallait caractériser la déportation des civils hongrois du point de vue de ses conséquences, le seul nom qu’on pourrait lui donner est : déportation en vue de travaux forcés débouchant sur une mortalité de masse.
Tamás Pataki
—
Traduit du hongrois par le Visegrád Post