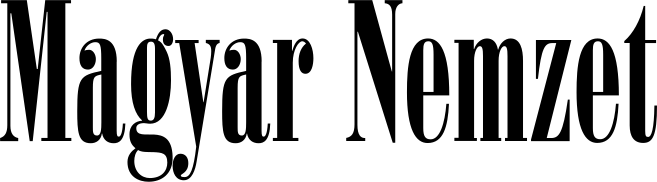Article paru dans le Magyar Nemzet le 12 mars 2021.
Une société ne pouvant être ouverte, l’usage de cette expression mène à des distorsions conceptuelles. Ces deux mots que l’usage accole – « société » et « ouvert » – sont antinomiques. Toutes les sociétés de l’histoire ont existé à l’intérieur d’un cadre donné, et c’est toujours le cas : c’est le seul modèle fonctionnel. C’est ce que les frontières nationales symbolisent le mieux, en limitant des unités géographiques peuplées par ceux qui appartiennent à la même nation. Même la suppression des frontière internes de l’Union européenne, quoiqu’officiellement proclamée, n’est restée effective en pratique que jusqu’à l’arrivée du premier coup dur – déferlement de masses de clandestins, ou pandémie inopportune –, après quoi on découvre très vite que, finalement, il existe tout de même une frontière entre l’Allemagne et l’Autriche, et que, dès qu’il faut trouver une solution à un problème indésirable, le Danemark et d’autres pays de l’Union réinterprètent ces lignes de défense jadis jugées superflues. En d’autres termes : le principe des « frontières ouvertes » est caractéristique d’une période de consolidation, de vie sans problèmes et sans besoins de protection.
Face à toute nation, la logique perverse de la « société ouverte » remet automatiquement en cause ses particularités culturelles, sa communauté linguistique, son identité idéologique et religieuse. Or quiconque cherche à assouplir ou à nier ces structures remet sciemment en cause le sens de sa propre existence, et se place lui-même au ban de la communauté sociale. Il peut vivre dans le pays de son choix, mais uniquement à titre d’hôte bienvenu. Il peut s’installer où il veut – à l’exception peut-être pas si surprenante de quelques pays arabes –, mais le droit de vote est réservé à ceux qui acceptent les règles de l’intégration. Il jouit comme tout le monde de la protection du droit, à condition de vivre dans le respect du droit, mais ne peut pas prendre part à sa définition à travers la représentation législative. Et ces règles s’appliquent aussi à ce monde occidental si tolérant en paroles : si tel n’était pas le cas, pourquoi y chercherait-on à expulser, en vertu de décisions de justice, des gens qui ne sont pas disposés à respecter les conditions prescrites par les pays d’accueil ?
Même en plein milieu des changements d’époque et des mutations sociales, il existe des régularités, des valeurs fondamentales et, de temps à autre, des erreurs qui, de toute évidence, demandent à être corrigées de toute urgence. Mais, à l’origine de tout processus objectif, on trouve l’homme – ecce homo –, qui gouverne les événements. L’homme qui crée, forge des idéaux, porte, en possession des facultés qu’il doit à son créateur, la responsabilité du développement qui incombe à son époque. L’homme, jamais exempt de traits de personnalité individuels, qu’ils soient positifs et pointent vers l’avenir, ou au contraire monstrueux, et de telle nature que leur mise en pratique ne peut qu’exposer la majorité à des catastrophes.
Il s’est souvent avéré – quoiqu’en général rétrospectivement – que des personnalités historiques proéminentes avaient dû certaines de leurs idées et de leurs exploits à des lacunes de leur personnalité. D’une part, il existe une puissance créatrice, qui les fait sortir du lot. D’autre part, il y a cette faiblesse de leur égo, cette difformité par laquelle ils s’éloignent sciemment de la normalité. La question est de savoir laquelle prendra le dessus. Les idées extrêmes qui ont pointé leur nez dans les théories des écoles philosophiques des XIXe et XXe siècles, et qui ont entre-temps fait la preuve de leur virulence, il est bien évident qu’elles ont fait leur effet, et que les gens, encore aujourd’hui, vivent sous leur influence. Parmi les précurseurs idéologiques des théories de la « société ouverte », on trouve des noms comme ceux de Marx, Engels, Antonio Gramsci, Max Horkheimer ou Herbert Marcuse, dans la vie desquels ces deux personnalités peuvent être mises à jour avec précision.
Marx, patriarche de l’idéologie communiste – à l’instar de Horkheimer, qui a dirigé l’école de Francfort – est devenu apatride, devant fuir l’Allemagne. Marx a dû se réfugier en Grande-Bretagne, tandis que Horkheimer émigrait aux États-Unis. Il est hors de doute, et facile à comprendre, que l’un des éléments essentiels de leur pensée philosophique soit la recherche d’une vie cosmopolite, la négation du modèle social existant, à travers laquelle ils s’efforçaient de formaliser la perspective d’une existence a-nationale. Dans les thèses philosophiques de l’italien Antonio Gramsci, qui souffrait de tares physiques et mentales, et dont la courte vie – il est mort à l’âge de 46 ans – a souvent été marquée par les privations, l’hypothèse de l’absence de toute alternative à la lutte des classes fait écho aux difficultés de sa vie.
Tout est révolution : la vie consolidée n’étant que le symbole condamné d’un monde périmé, il ne faut pas hésiter – nous explique-t-il – à faire couler le sang et à déstabiliser la nation – sacrifices nécessaires sur l’autel d’un nouvel âge. On peut ranger dans le même ordre d’idées l’anti-religiosité de Engels, dont les racines se trouvent dans la maison de son père. Fuyant la dictature d’un père profondément croyant, mais rêche et impitoyable, le jeune Engels, pour autant, n’en veut pas à son père, mais voit – non-sens horripilant – dans la religion elle-même la source de ses déboires. Herbert Marcuse, l’une des idoles des révoltés de 1968, n’échappe pas à la règle : un rayonnement nocif émane, sourdement, de sa personnalité. L’idéal de l’amour libre, d’un renversement de tous les tabous de la vie sexuelle, de par sa nature même, s’est d’abord répandu dans la jeunesse, sous des dehors qui choquaient la société. Cette comparaison entre les penseurs susmentionnés comporte, indéniablement, une part de spéculation, mais la détermination subjective de l’homme enclin aux déviations est observable dans la symbolique qui les entoure.
Mais il y a plus grave : dans leurs caractéristiques personnelles et dans leur rapport au monde, il n’est pas difficile de découvrir des similitudes entre ces précurseurs et ceux qui propagent actuellement l’idéologie de la « société ouverte ». Car enfin, leur volonté de penser par-delà les nations, leur théorie du genre et leur tentative de redéfinition du concept de famille montrent bien l’impasse idéologique dans laquelle ils nous engagent à marche forcée. On a l’impression que leur philosophie de la « société ouverte » est une sorte de clé destinée à faire sauter les cadres nationaux. C’est dans l’entrebâillement de cette pote déjà entrouverte que s’engouffre subrepticement le vent de « temps nouveaux ». Comment expliquer que, dans leur vision des choses, les habitants du poulailler puissent aussi être considérés comme des membres de la famille ? C’est ici qu’il faut affirmer sans détours que la famille – et cela ne changera jamais – signifie : une mère, un père et leurs enfants, tandis que les chiens, les chats et autres animaux peuvent être des amis de la famille, mais pas des membres de cette dernière.
La tâche qui nous incombe est donc de refermer en la claquant la porte de la société, comme format fondamental de la communauté des hommes, devant ces idéologies déviantes. Quant aux éléments qui ont déjà réussi à passer le seuil de nos défenses immunitaires, ils constituent un défi quotidien pour tous ceux qui souhaitent prendre le parti des valeurs fondamentales de l’humanité. Indépendamment des appartenances partisanes de chacun, tous devraient comprendre que l’ouverture véritable, c’est d’assumer la responsabilité de l’avenir, et non de caresser des rêves d’anarchie découchant sur une dévastation prévisible.
László Földi
Expert en questions de sécurité nationale
—
Traduit du hongrois par le Visegrád Post