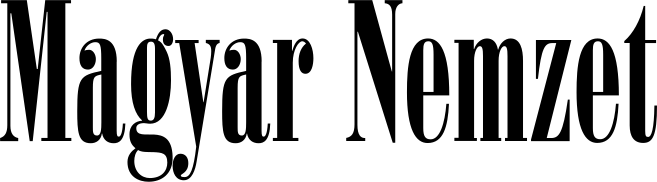Article paru dans le Magyar Nemzet le 6 décembre 2021.
Épigraphe :
« T’imagines, mon vieux, le ricanement de ce Satan bruxellois qui a trouvé l’idée géniale de nous obliger à utiliser le prénom musulman Malika au lieu de Marie ? Eh ben, c’est avec ce ricanement en travers de la gueule qu’ils comptent étouffer l’Europe, financièrement, économiquement, politiquement, démographiquement et mentalement. Mais avant tout mentalement. Parce qu’après, tout le reste ne sera plus qu’un jeu d’enfant. » (Texto envoyé par un ami après la découverte du plan secret de la Commission européenne.)
Fille d’un roi phénicien, Eurṓpē cueillait des fleurs au bord de la mer lorsque Zeus, l’ayant aperçue, est aussitôt tombé amoureux d’elle. Prenant la forme d’un magnifique taureau blanc, il s’est approché de la jeune fille pour s’agenouiller devant elle ; quant à cette dernière, après lui avoir passé au col une couronne de fleurs, elle est montée sur son dos. Détalant alors à toute vitesse, Zeus ne s’est pas arrêté avant d’atteindre l’île de Crète, où, reprenant sa forme humaine, il fit sienne sa cavalière, qui donna ensuite naissance à trois enfants – Sarpédon, Rhadamanthe, et le plus célèbre des trois : Minos.
Voilà la merveilleuse légende d’Eurṓpē. Aujourd’hui, bien entendu, tout cela ne représente plus qu’un motif d’indignation de type #metoo.
Car ceux qui, tout en ayant très envie, n’ont jamais rien réussi, ceux-là haïssent. Ceux qui haïssent aujourd’hui sont ceux qui haïssent vraiment. (Et le moyen le plus sûr de s’en rendre compte, c’est que ceux-là parlent en permanence d’amour : ils aiment tout le monde, et il faut aimer tout le monde.) Ceux qui haïssent véritablement, ceux-là se bricolent une idéologie ad hoc. Avec une idéologie, déjà, tu deviens quelqu’un. Mais à partir de là, tu es obligé de t’accrocher à ton idéologie et de continuer à haïr, sans ça, tu retombes dans le néant des désirs insatisfaits. C’est de cette façon que sont apparues toutes les idéologies pour malades de notre temps. Et c’est de cette façon que sont apparues toutes les idéologies pour malades de tous les temps : du jacobinisme jusqu’au nazisme et du bolchévisme jusqu’au #metoo et aux « campus » actuels, sur lesquels les deux lieux les plus importants sont le safe space et la chaire des études de genre. (Si tu me crois pas, t’as qu’à jeter un œil à Zita Gurmai [députée au Parlement hongrois pour le compte du Parti socialiste hongrois – n.d.t.] brandissant sa pancarte metoo. Ah, tu vois bien…)
Ceux qui souffrent de haine de soi ont tendance à se projeter dans le monde qui les entoure. Ce genre de personnalité a toujours existé. Sauf que jusqu’à présent, il n’est encore jamais, mais jamais arrivé qu’ils soient tellement terre-à-terre. Car, comme nous avons entendu Péter Gothár le dire (après quoi il s’est fait descendre comme il faut, alors même qu’il avait longtemps disposé d’un petit pedigree pas dégueu dans la gauche libérale) : « La ramener, c’est une chose, mais tout dépend du niveau auquel on le fait… »
Babits restait attaché à un certain niveau :
Le seul qui sache être héros de mon poème, c’est moi / le premier et le dernier dans chacun de mes chants : / j’aspire à saisir l’univers dans un poème, / mais je ne suis jamais arrivé au-delà de ma personne. // Et je finis par croire qu’il n’existe rien en-dehors de moi, / mais – à supposer qu’il existe – Dieu, lui, qu’en pense-t-il ? / Il arrive à la noix de rester enfermée dans une noix / et d’attendre qu’elle se casse, bah, je suis dégoûté. // Pas moyen d’échapper à ce cercle ensorcelé que je suis, / seule ma flèche peut bondir au-dehors : mon désir – / mais je le sais bien : l’intuition de mon désir me trompe. // Je reste, quant à moi, ma propre prison, / car le sujet, tout comme l’objet, c’est moi, / hélas je suis l’oméga, hélas je suis l’alfa.
Mais ces gamins d’aujourd’hui, ils ne sont plus sujets au dégoût. Eux, en effet, ne connaissent pas l’altérité – mais seulement eux-mêmes, plus la projection de leur haine de soi, de leur ratage, et l’idéologie qu’ils se sont bricolée à partir de là. Cette idéologie, bien entendu, prétend toujours transformer la totalité du monde. Eh oui, comment se contenter de moins ? Celui qui n’a rien, à celui-là, il lui faut le monde entier – et tout de suite ! Car enfin, ils souffrent de haine de soi, et pensent par conséquent que le monde doit être transformé. Car il est bien entendu que la faute en revient au monde.
Comme l’a écrit Albert Camus à propos des nazis : ces fous auraient été capables d’anéantir le monde entier – si eux ne peuvent pas vivre éternellement, que rien ne leur survive. Ce crime, dans son impénitence, est au moins grandiose. Mais continuons à écouter Camus, pour que notre désillusion soit complète : « Mais à partir du moment où, faute de caractère, on court se donner une doctrine, dès l’instant où le crime se raisonne, il prolifère comme la raison elle-même, il prend toutes les figures du syllogisme. […] L’idéologie, aujourd’hui, ne nie plus que les autres, seuls tricheurs. […] Mais cette réflexion, pour le moment, ne nous fournit qu’une seule notion, celle de l’absurde. […] Si l’on ne croit à rien, si rien n’a de sens et si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, tout est possible et rien n’a d’importance. Point de pour ni de contre, l’assassin n’a ni tort ni raison. On peut tisonner les crématoires comme on peut aussi se dévouer à soigner les lépreux. Malice et vertu sont hasard ou caprice. […] Aussi bien, le nihilisme absolu, celui qui accepte de légitimer le suicide, court plus facilement encore au meurtre logique. […] L’homme est la seule créature qui refuse d’être ce qu’elle est. »
Pas mal, hein ? Surtout ça : « Si l’on ne croit à rien, si rien n’a de sens et si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, tout est possible et rien n’a d’importance. » Et ça : « L’homme est la seule créature qui refuse d’être ce qu’elle est. » Voilà pourquoi les hommes peuvent désormais accoucher. Étant donné que plus rien n’a de sens. Le crime grandiose qui voulait « que le monde entier disparaisse avec nous » a accouché de la souris atteinte de nanisme qui réclame « que les hommes puissent eux aussi accoucher ».
Quant à la conscience collective de l’humanité, qui embrassait les millénaires, et à la perspective individuelle, qui formait un trait d’union entre les générations, elles ne s’étendent plus que – rétrospectivement – jusqu’à la télé achetée bon marché lors du black Friday de l’année dernière, et – en direction de l’avenir – jusqu’aux likes que devrait me valoir ce que je compte poster demain sur Facebook. Où est passé l’homme révolté de Camus ? « La révolte naît du spectacle de la déraison, devant une condition injuste et incompréhensible. Mais son élan aveugle revendique l’ordre au milieu du chaos et l’unité au cœur même de ce qui fuit et disparaît. Elle crie, elle exige, elle veut que le scandale cesse et que se fixe enfin ce qui jusqu’ici s’écrivait sans trêve sur la mer. » Mais aujourd’hui, nous n’avons même plus de pierre où graver quoi que ce soit : il ne nous reste que la mer. Permettez-moi d’insister – voici ce que Camus écrivait à propos des nazis, de la terrible année 1945 : « Cette logique a poussé les valeurs de suicide dont notre temps s’est nourri jusqu’à leur conséquence extrême qui est le meurtre légitimé. Du même coup, elle culmine dans le suicide collectif. La démonstration la plus éclatante a été fournie par l’apocalypse hitlérienne de 1945. Se détruire n’était rien pour les fous qui se préparaient dans des terriers une mort d’apothéose. L’essentiel était de ne pas se détruire seul et d’entraîner tout un monde avec soi. »
Ça, c’est le crime grandiose. Dont même les Jacobins étaient encore capables. Eux aussi, bien entendu, ont commencé par vouloir changer le monde entier. Ils ont même pensé à rebaptiser les mois de l’année. Il leur fallait une nouvelle ère, étant donné que le calendrier grégorien des Chrétiens ne pouvait en aucun cas convenir à leur réalité païenne et satanique de négateurs du divin – tout barbare porte en lui la ferme conviction que c’est avec lui que commencent le monde digne de ce nom et la vraie vie. Voilà pourquoi ces monstres avaient besoin de leur propre calendrier – d’un calendrier « révolutionnaire ». Et voilà comment le calendrier grégorien, qui faisait commencer l’année à la naissance du Christ, s’est retrouvé balancé aux ordures, pour céder la place au « calendrier révolutionnaire », dans lequel les noms de mois renvoyant au christianisme, voire à l’Antiquité, sont remplacés par des noms « rationnels » : Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, Nivôse, Pluviôse, Ventôse, Germinal, Floréal, Prairial, Messidor, Thermidor, Fructidor – ah, quelle splendeur ! Et maintenant qu’on a rebaptisé les mois, eh bien, on peut aller massacrer : en Vendée, ils sont tombés à bras raccourcis sur leur propre nation – car c’est toujours à leur propre nation que ces gens-là s’en prennent –, tuant par milliers les paysans, les prêtres, les nonnes et les moines, enivrés par l’odeur du sang, et bien sûr aussi par leur propre « grandeur » et leur propre « courage ».
Et tout cela était encore bien présent à l’esprit des Bolchéviques, qui ne tardèrent pas à apparaître pour « faire table rase du passé », et, bien sûr, pour massacrer à droite et à gauche, des millions d’hommes, puisqu’ils en avaient le temps : au sous-sol de la maison Ipatiev, ils ont achevé des enfants à la crosse de fusil, et ils en étaient fiers, et pas qu’un peu ! …
Et ceux d’aujourd’hui ? Eh bien, ceux-ci, on ne peut pas dire qu’ils soient très courageux. Pour l’instant. Pour l’instant, ils en restent à la refonte du vocabulaire et à l’effacement du passé. Ils ne veulent détruire que le monde normal, pour ensuite faire récolte de likes en se plongeant jusqu’au poitrail dans la merde de l’anormalité.
Quand on est incapable de laisser la moindre trace de soi en ce monde, parce qu’on n’est rien, alors, on se met à effacer des mots, à priver les mots de leur sens d’origine, à effacer de la conscience collective des valeurs qu’on a pu croire éternelles, à jeter l’anathème sur le passé et sur ses grandeurs, mais – désormais – sans se sacrifier soi-même, eh ! oh ! – une larve genderfluid, c’est pas fait pour crever sur une barricade !
« C’est ainsi qu’en ce triste siècle, les choses les plus sublimes, les plus spirituelles, se dissolvent dans les combats de la vie d’ici-bas, de cette vie – oserais-je dire – corporelle – combats qui culminent et se parachèvent dans la lutte des races et des nations, tout comme les animaux se battent entre meutes, ruches et essaims. Sur cette pente, il est impossible de s’arrêter ; les socialistes ont beau proclamer – voire parfois croire eux-mêmes – être les héros spécialisés de la paix et de la communauté des hommes : ils ne font que descendre une marche de plus sur cet escalier, en remplaçant simplement les luttes de la race et de la nation – encore nobles et altruistes, encore supérieures aux convoitises directes de l’individu – par les luttes – aux fins exclusivement et explicitement matérielles – de syndicats qui se battent pour améliorer le niveau de vie de l’individu.
Dans la vie corporelle et pratique, se battre pour du pain est certes une chose importante et vitale – mais ceux qui élèvent une telle lutte au rang d’axe central de la culture humaine – comme le font les scribes du socialisme –, ceux-là identifient d’ores et déjà la culture humaine à celle des animaux. La pensée, la religion, la morale et l’art – tout ce dont la conservation repose sur les épaules des scribes, tout cela perd toute valeur dans une telle culture, qui ne sait plus apprécier que les instincts, les actions et leur profit. Or notre culture ressemble déjà tellement à une telle culture que le vrai, le bon et le beau n’y figurent déjà presque plus comme concepts et comme qualificatifs valorisants – leur place étant usurpée par le vital ou par le social, par le national, par le tellurique ou par l’actuel. »
Cela aussi, Babits l’avait très bien vu. Et quand on voit où nous en sommes arrivés depuis cette lutte pour le pain quotidien – Dieu du ciel ! –, vu d’ici, même cette lutte-là nous semble déjà sublime. Car aujourd’hui, c’est la lutte des organes génitaux qui fait rage ; pour les gamins d’aujourd’hui, même la lutte pour le pain, c’est déjà bien trop héroïque. Tout ce qui leur reste, tout ce qui leur échoit, c’est la lutte pour les organes génitaux, la lutte pour obtenir qu’ils deviennent interchangeables, pour qu’ils puissent s’échanger leurs propres parties génitales comme à une brocante. En comparaison, l’existence porcine est tout ce qu’il y a de plus sublime. Une tranche de lard : le nirvana de l’existence porcine. Et effectivement : « Le bonheur, moi, je l’ai vu, / il était tendre, blond, et pesait un quintal et demi. / Sur la pelouse précise de cette cour / son sourire tout bouclé titubait. / Il s’est vautré dans sa flaque de boue tiède et douce, / clignant des yeux, grognant à mon endroit – / je vois encore comme, incertaine / la lumière sautillait dans ses soies. »
Eh oui. Mais Attila József [auteur du poème ci-dessus – n.d.t.], lui, restait capable d’élever son regard jusqu’à ces « rouages des cieux » – même s’il est vrai qu’il n’y voyait plus que « le tissu de la loi qui toujours quelque-part s’effiloche ».
Mais même cela reste plus sublime que ce à quoi s’amusent ces gamins d’aujourd’hui, dont le regard porte jusqu’à la braguette de leur propre culotte, et jusqu’à celle de la culotte des autres, et aussi jusqu’à la braguette des enfants – mais c’est toujours celle des enfants d’autrui, étant donné qu’eux-mêmes, des enfants, ils n’en ont pas… (Suite au prochain épisode)
Zsolt Bayer
—
Traduit du hongrois par le Visegrád Post