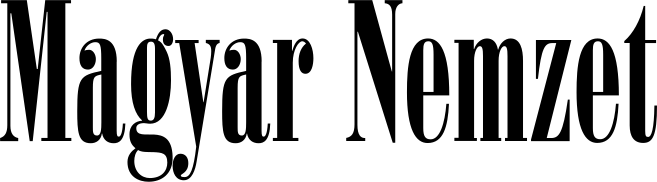Article paru dans le Magyar Nemzet le 4 avril 2022.
Jusqu’ici, il n’était déjà pas facile de s’y retrouver dans les déclaration de Péter Márki-Zay, candidat malheureux de la gauche aux élections de dimanche dernier, qui se contredisait lui-même en permanence et changeait d’opinion d’une heure à l’autre (rappelons qu’il n’a pas été capable de se souvenir de l’heure fixée pour son propre discours d’évaluation de l’année écoulée, qu’il est capable, au cours d’une même émission, de citer quatre dates différentes pour le même événement, et n’a jamais réussi à se réconcilier non plus avec la prononciation du nom de l’actuel président ukrainien). Cependant, outre le fait que – fidèle en cela à l’exemple de ses prédécesseurs et modèles – il a oublié de féliciter son rival victorieux, il a encore réussi à cracher un dernier mensonge historique à la figure de ceux que leur curiosité a poussés à regarder jusqu’aux toutes dernières convulsions son numéro de kamikaze politique (également connu sous le nom de « campagne du candidat de la gauche hongroise aux fonctions de Premier-ministre »).
Une fois informé des résultats définitifs du scrutin, largué sans autre forme de procès par ses alliés, Péter Márki-Zay a exploré de nouvelles profondeurs de veulerie politique, en expliquant que « c’est ce que l’histoire nous enseigne : Milošević aussi était très populaire au moment où l’OTAN a commencé à bombarder son pays et,
même en 1945, Hitler aurait lui aussi obtenu une majorité des deux tiers en Allemagne, dans Berlin assiégé. »
Cependant, cette déclaration concernant le Troisième Reich nazi contient une « petite » erreur. Il est en effet historiquement avéré qu’en avril 1945, au moment où l’étau se resserre autour de Berlin, le plus gros des soldats de la Wehrmacht avaient déserté ou avaient déjà été fait prisonniers, si bien que de nombreuses unités de l’armée n’existaient plus que sur le papier ; on peut donc dire que ses propres soldats ne jugeaient plus Hitler capable, non seulement de réaliser ses rêves de domination mondiale, mais même de défendre leur patrie. Ses troupes rapiécées à l’aide de gamins de 12 ou 13 ans n’ont pas réussi à ralentir de beaucoup l’avance des Alliés : elles n’avaient pas la moindre chance, et cela, depuis la capitulation de son armée à Stalingrad le 2 février 1943, chaque jour qui passait lui laissait moins de chances de l’ignorer.
C’est alors que la société allemande a commencé à soupçonner l’inévitabilité de la défaite catastrophique qu’allait subir l’axe Berlin–Rome–Tokyo, et, lorsque le 6 juin 1944 les Anglo-Américains ont débarqué en Normandie, pour une grande majorité ce soupçon s’est transformé en certitude. Même si, au cours de ses premières journées, la dernière contre-offensive allemande – celle de décembre 1944 dans les Ardennes – a rendu à certains un peu d’espoir, les Américains, se ressaisissant bien vite, ont repoussé l’offensive : c’est ainsi qu’a été dispersée la toute dernière attaque de l’Allemagne nazie. A partir de ce moment, la machine de propagande d’Hitler ne parvenait pratiquement plus à faire croire quoi que ce soit au peuple allemand – pas même l’omnipotence des fameuses « armes miracle » dont on lui remplissait les oreilles vers la fin de la guerre (et pourtant, de telles armes existaient bel et bien, mais leur développement avait commencé trop tard – l’exemple le mieux connu étant probablement celui des missiles V–1 et V–2, mais la liste inclut aussi divers armements que les Alliés allaient, après la fin de la guerre, finir de développer eux-mêmes à partir d’une intuition initiale des Allemands).
Si le Troisième Reich avait eu des instituts de sondage professionnels et objectifs (il n’en avait pas), ce qu’ils auraient révélé, c’est que l’indice de popularité du Führer n’avait de cesse de baisser, jusqu’à tomber à zéro en avril 1945
– abstraction faite, bien entendu, des adolescents inconscients qui poursuivaient encore un combat désespéré, et d’une petite minorité fanatisée au sein de l’état-major. Hitler lui-même en était d’ailleurs parfaitement conscient, comme nous l’apprend le journal du lieutenant Hans Baur, qui lui est resté fidèle jusqu’au bout. On y découvre qu’au moment où le Führer de cet empire tombé de haut, avant de se suicider, a pris congé de ses amis, il se rendait parfaitement compte de la disparition – non pas d’une majorité des deux tiers, mais de tout soutien populaire. Très peu de temps avant sa mort, il aurait en effet affirmé que « le moment est venu. Mes généraux m’ont trahi, mes soldats ont déposé les armes, je ne suis pas en mesure de poursuivre le combat. Un homme doit avoir le courage de regarder en face les conséquences de ses actes – raison pour laquelle j’ai décidé d’en finir. Je sais que, demain, des millions de gens vont me maudire. Mais moi, aujourd’hui, je vais en finir. »
Consignés de façon authentique, ces propos collent parfaitement à la réalité politique du moment en question : jusqu’au tout dernier moment, évidemment, Hitler était, dans son bunker, tenu informé par ses agents des événements du monde extérieur – raison parmi d’autres, pour lui, d’être certain du fait que, s’il avait osé sortir dans la rue, les plus sanguins des Allemands auraient très bien pu décider de le lyncher. Ainsi,
s’il y a bien une chose dont on peut être absolument certain, c’est qu’en avril 1945, Hitler était aussi loin d’une majorité des deux tiers que la terre est éloignée du ciel.
Il semble néanmoins que Péter Márki-Zay ait préféré ne pas prendre connaissance de ces faits, trouvant, dans son discours d’hier, plus simple de débiter de grandes phrases dont pas un traître mot ne correspondait à la réalité. Or ce révisionnisme qui, chez lui, est devenu pour ainsi dire habituel, n’est plus désormais que la cerise sur le gâteau. En effet, hier
Márki-Zay a non seulement raté une fois de plus son examen d’histoire, mais il s’est aussi fait recaler en tant qu’acteur sur la scène de l’histoire politique hongroise.
Bence Csatári
Historien
—
Traduit du hongrois par le Visegrád Post