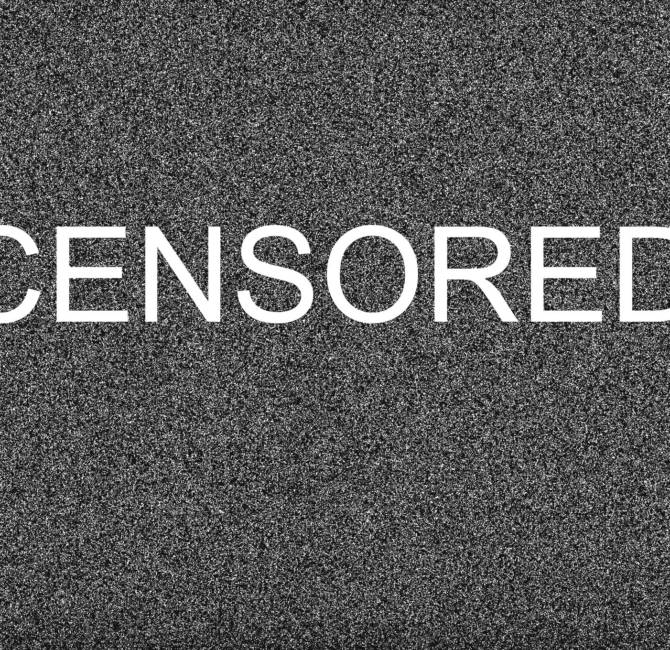Par Olivier Bault.
Pologne – Le thème de l’antisémitisme polonais est de retour. Avec la nouvelle loi mémorielle polonaise, la Pologne est attaquée de toutes parts, et en particulier depuis Israël et les États-Unis. Après s’être un peu calmées, les attaques sont reparties de plus belle quand le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, répondant à la question d’un journaliste israélien, a assuré que la loi polonaise n’interdisait pas de témoigner des crimes commis pendant la Deuxième guerre mondiale, que leurs auteurs aient été polonais, russes, ukrainiens ou juifs. Oui, juifs, c’est arrivé aussi mais c’est peu connu des historiens hors de Pologne et cela a suffi pour faire renaître la polémique. Les choses semblent se calmer à nouveau un peu aujourd’hui malgré une ambassadrice d’Israël en Pologne qui semble ne pas rater une occasion de jeter de l’huile sur le feu par ses propos extrêmement blessants pour les Polonais. Il y a quelques jours, elle assurait qu’elle avait pris conscience ces dernières semaines combien il était facile de réveiller chez les Polonais les démons de l’antisémitisme. L’ambassadrice Anna Hazari se référait non pas à des agressions qui n’ont pas eu lieu mais aux critiques des Juifs et d’Israël dans le cadre de la polémique actuelle. Malgré les efforts de cette diplomate bien peu diplomatique, un dialogue a été renoué entre Pologne et Israël pour parler d’histoire et voir si la loi mémorielle polonaise pourrait être modifiée afin de rassurer ceux qui craignent de voir la liberté d’expression sur la Shoah muselée. Le président polonais Andrzej Duda a par ailleurs saisi la Cour constitutionnelle sur la question et celle-ci, par son interprétation de la loi, pourrait apporter les garanties nécessaires.
Mais un autre facteur vient remettre sur la table la question du rôle joué par les Polonais pendant la Shoah : le cinquantenaire des événements de Mars 68. L’un des arguments avancés pour prouver une part de responsabilité des Polonais dans la Shoah, c’est en effet la persistance d’un antisémitisme supposé virulent après la guerre. Pour cela, on se réfère le plus souvent au pogrom de Kielce en 1946 et à la campagne antisémite de 1967-68 qui conduisit à une vague d’émigration des Juifs de Pologne, vidant le pays de la majorité des survivants d’un peuple avec lequel les Polonais avaient cohabité pendant plusieurs siècles. Cette campagne antisémite, qui avait commencé après la Guerre des Six Jours (le bloc soviétique avait pris position pour les Arabes contre Israël), s’intensifia grandement en Pologne après la révolte des jeunes (étudiants, ouvriers…) de mars 1968. Une révolte déclenchée dans les universités après la mise à l’index de deux pièces de théâtre par le pouvoir communiste quand le Premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais (le parti communiste aux ordres de Moscou) était Władisław Gomułka.
Aujourd’hui, la lecture de cette campagne antisémite varie grandement selon que l’on est Juif d’origine polonaise ou Polonais avec ou sans origines juives, et aussi selon que l’on a des convictions de gauche ou de droite. En gros, pour les uns la campagne antisémite de 1968 a été une vague de fond certes provoquée par le pouvoir communiste mais nourrie par un antisémitisme latent dans la population, tandis que les autres rappellent que la Pologne n’était pas indépendante en 1968 puisqu’elle était dirigée par une dictature imposée par Moscou, et ils réduisent donc la campagne antisémite de 1967-68 à un règlement de compte interne au Parti communiste. En effet, les Juifs polonais étaient largement surreprésentés dans les structures dirigeantes de la dictature communiste stalinienne mise en place par l’occupant soviétique juste après la Deuxième guerre mondiale. En 1968, les « sionistes » furent invités par Gomułka à partir si leur allégeance allait d’abord à Israël. Ce fut aussi une année où les structures du Parti et de l’armée connurent une importante épuration, notamment, en ce qui concerne l’armée, sous la direction du général Jaruzelski, à l’époque chef d’état major et antisémite notoire (en plus d’être christianophobe, chargé à l’époque stalinienne des répressions contre les séminaristes dans le cadre de leur service militaire obligatoire) tout comme Gomułka. Il mérite d’être remarqué au passage que beaucoup de Polonais auraient souhaité quitter la Pologne communiste en 1968, mais que seuls ceux avec des origines juives le pouvaient. C’est une opinion entendue par l’auteur de ces lignes d’un Juif polonais émigré en Australie en 1968 et revenu s’installer en Pologne après la chute du communisme. La relecture par la gauche polonaise des événements de Mars 68 et de la campagne antisémite qui a suivi, pour faire la démonstration de l’antisémitisme des Polonais, date des années 90. Elle est notamment le fait des milieux liés au journal Gazeta Wyborcza sous la direction de son rédacteur en chef Adam Michnik, lui-même issu d’une famille juive communiste (son frère était un juge stalinien qui s’enfuit en Suède après les événements de mars 68) mais passé à la dissidence en mars 68 : ce fut son expulsion de l’Université de Varsovie qui déclencha la révolte.
Malgré les lectures divergentes des événements déclenchés le 8 mars 1968, le parlement polonais est parvenu le 7 mars dernier à se mettre d’accord (chose rarissime en ce moment) sur une résolution commémorant le cinquantenaire.
Mais pour mieux comprendre les événements de 1968 en Pologne, le mieux est de donner la parole à un témoin direct : un Juif polonais manifestant de Mars 68, victimes des répressions, émigré en 1969. Le texte ci-dessous est une lettre ouverte adressée au musée de l’Histoire des Juifs polonais « Polin » de Varsovie, pour lui reprocher d’avoir intitulé une exposition sur Mars 68 « Étrangers chez eux ». Né en 1946, Bronisław Świderski réside au Danemark depuis 1969. Traducteur de Kierkegaard du danois au polonais, auteur de plusieurs ouvrages, dont certains ont été récompensés, il est membre de l’association des écrivains polonais (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich). Świderski conteste s’être jamais senti, en tant que Polonais avec des origines juives, étranger en Pologne. Pour lui, la fracture en 1968 n’était pas entre Polonais et Juifs, mais entre le pouvoir communiste et le peuple.
Lettre ouverte au directeur du musée de l’Histoire des Juifs polonais Polin à propos du programme « Étrangers chez eux. Autour de mars 68 »
Bronisław Świderski
L’expression « Étrangers chez eux », qui est l’intitulé des commémorations du cinquantième anniversaire des événements de mars 1968, semble comporter une double erreur. Premièrement : le message de base des événements de mars était-il vraiment un message de division ou au contraire d’unité ? Deuxièmement : en attribuant aux Juifs la qualification « d’étrangers », c’est-à-dire de gens privés de droits dans leur pays, on en fait exclusivement des victimes. Cela correspond bien entendu à la mode actuelle consistant à victimiser l’histoire juive, en se fondant sur la conviction pas forcément juste selon laquelle « la victime a toujours raison ».
Le plus drôle, c’est que cet intitulé n’a pas été inventé par le musée Polin. C’est en fait la répétition mot-à-mot d’une expression utilisée dans les discours antisémites de Gomułka en mars 68. C’est lui qui, avec son intonation neurotique, sépara les Polonais et les « sionistes », qu’il décida de chasser. Cette expression n’a jamais été une description objective des événements de mars, mais un slogan politique des antisémites.
Ce partage à la hache le long de la « ligne du sang » correspond au programme nationaliste présent dans les deux groupes ethniques. Il ne reflète cependant pas la réalité des événements de cette époque.
Mars 68, c’était tout le contraire : c’était la preuve que nous étions tous des Polonais, que la frontière ne passait pas entre groupes ethniques mais entre le pouvoir communiste et le peuple. Cela a été démontré par Jerzy Eisler dans son deuxième livre sur Mars 68 intitulé /L’année 1968 polonaise/ (dont j’ai parlé dans mon texte Mars 68 – un mythe romantique ?, paru dans Europa, et accessible sur Internet). L’historien y soulignait la prédominance des jeunes ouvriers polonais dans les événements qui secouèrent le pays. La conclusion d’Eisler confirme le soutien de ce groupe à la lutte étudiante : « entre le 7 mars et le 6 avril, 2.725 personnes furent arrêtées dans tout le pays dont 937 ouvriers, soit 300 de plus que les étudiants ». Mars 68 était-il donc un mouvement d’étudiants que Gomułka appelaient « étrangers » ou d’ouvriers polonais ? Pourquoi les employés du musée Polin n’ont-ils pas pensé à ce que ressentiraient ces ouvriers en entendant à nouveau l’écho des paroles de Gomułka, clamant que leur courage et leur activisme servaient les « étrangers », les Juifs ?
Quand nous manifestions en mars 68, nous n’étions en rien « étrangers ». Au contraire, nous témoignions à quel point nous nous sentions chez nous dans notre maison polonaise commune. En participant le 8 mars 1968 à la manifestation devant le siège du recteur de l’Université de Varsovie, j’étais avec d’autres étudiants polonais et je ne me sentais absolument pas différent. Condamné à un camp militaire punitif pour mon activisme de Mars 68, j’y rencontrai des étudiants ordinaires de nombreuses villes. Même un nationaliste zélé n’aurait pas idée d’appeler « étrangers » la plupart de ces étudiants. Nous étions unis face à un ennemi commun.
La révolte de Mars 68 s’est inscrite dans la lutte du peuple polonais contre le pouvoir des communistes. L’antisémite Gomułka a cherché à briser notre unité en présentant certains rebelles comme « étrangers », comme non-polonais, comme juifs. Il est étonnant et même choquant que le musée Polin se soit aussi facilement approprié cette idée antisémite pour son intitulé.
Mars 68 était un mouvement national, et les commémorations devraient être organisées par le musée de l’Histoire de Pologne plutôt que par celui de l’Histoire des Juifs polonais. En effet, nous, les participants à Mars 68, nous partagions cette lutte avec l’ensemble de la nation polonaise !
Il est vraiment surprenant qu’un musée tourné vers la connaissance de l’histoire fasse aussi facilement l’impasse sur les preuves historiques décrites par un historien, et préfère utiliser la rhétorique politique nationaliste de Gomułka. Je le répète : la reprise par le musée d’une expression de ce serviteur des Soviétiques est blessante, car nous savons bien que les respectables professeurs et spécialistes des musées polonais, habituellement sérieux et concrets comme des citrons séchés, n’utilisent pas l’ironie ni la parodie.
En outre, cette division nationaliste entre les Polonais, « hôtes dans leur pays », excluant de leur communauté les Juifs « étrangers », ne tient pas du tout face à la réalité des événements de Mars 68. Tous les Juifs n’étaient pas « étrangers » dans la République populaire de Pologne ! Ce ne sont pas des Polonais qui m’ont dénoncé à la police politique mais deux Juifs qui étaient ses collaborateurs confidentiels : l’un était le fils d’un général communiste, l’autre d’un censeur. Peut-être se sentaient-ils étrangers en Pologne et désiraient-ils très fort être reconnus comme faisant partie des siens par le pouvoir communiste. Ces deux délateurs, qui étaient à l’époque mes meilleurs amis, ont pu, grâce à leurs dénonciations, faire carrière en Pologne et ils ont obtenu des titres universitaires, tandis que moi, j’ai été renvoyé de l’université et contraint à l’émigration. Eux et moi, étions-nous de la même manière « étrangers chez nous », en Pologne ?
Par ailleurs, l’une des membres du jury du musée a participé activement aux événements de Mars 68, mais par sa collaboration zélée avec la milice communiste. Elle prit l’initiative d’écrire un long texte à l’usage de la police politique, un texte que l’on peut trouver aujourd’hui encore sur Internet. Mon nom, mon nom d’opposant au communisme, y figure plusieurs fois. Et il a fallu que le musée Polin désigne cette personne pour évaluer les histoires reçues à propos de Mars 68 ! Moi, participant persécuté des événements de Mars 68, j’ai eu l’audace (ou peut-être simplement l’imprudence) de témoigner dans un procès de Mars en défense d’un accusé. Autant que je sache, je suis le seul, parmi ceux qui ont participé a Mars 68, à avoir défendu des collègues au cours des procès politiques qui se sont déroulés à Varsovie à ce moment-là (j’en dis plus dans le texte évoqué plus haut à propos du livre d’Eisler). La police politique a immédiatement réagi en promettant de détruire ma vie, ce qu’elle a fait. La question reste toujours sans réponse : peut-on qualifier de la même manière celui qui dénonçait ses collègues et celui qui les défendait ?
Longtemps, je ne voulais pas quitter la Pologne. Ce qui a fait pencher la balance en faveur de ma décision, c’étaient les élections à la Diète de 1969. Ma mère juive, qui voulait très fort être Polonaise et ne voulait partir pour rien au monde, me prévenait paniquée que si je ne votais pas, ils viendraient chez nous, ils lui prendraient son travail et nous jetteraient à la rue. Mon père, élevé dans une famille d’ouvriers catholiques de Varsovie, s’était retrouvé en Russie en 1914, à l’âge de seize ans. C’est là-bas qu’il est tombé pour toute sa vie éperdument amoureux de Lénine et de Staline. Il n’arrivait pas à me pardonner le fait que j’étais un ennemi du communisme. La haine de mon père et les lamentations de ma mère me poussèrent à aller voter. Bien entendu, j’avais l’intention de barrer, barrer et encore barrer… Au bureau de vote, je montrai ma carte d’identité et on me donna un bulletin de vote. L’urne se trouvait sur la table de la commission électorale, il suffisait d’y jeter son bulletin. Dans un coin éloigné de la pièce se trouvait un petit espace avec un modeste rideau. À côté, un homme de forte carrure était assis, certainement un membre de la police politique, avec un papier et un crayon. Personne dans le bureau de vote ne s’approchait de lui. Chacun jetait son bulletin dans l’urne sans même le regarder. Je savais que passer derrière le rideau et barrer tous les noms – ce dont j’avais une énorme envie – ne changerait rien au résultat des élections qui avait été fixé avant le vote. Par contre, cela pouvait attirer des répressions contre ma famille. Les fraudes des communistes n’étaient en effet un secret pour personne. Si j’avais barré les noms, j’aurais été content de moi, et en même temps j’avais conscience que cela porterait préjudice à ma famille. Avais-je le droit d’agir ainsi ? Mais avais-je aussi le droit de tirer un trait sur ma participation à Mars 68 ? Après un moment d’hésitation, je jetai le bulletin intact dans l’urne et je sortis. Peut-être ai-je alors sauvé l’existence de ma famille, mais je me suis trahi moi-même. Je sentais le goût métallique du mors dans ma bouche, un goût que connaît tout esclave. C’est aussi pour cela que j’ai décidé de quitter la Pologne. Suis-je devenu « étranger » en partant, ou ai-je au contraire continué à cultiver la tradition polonaise de la protestation ?
Quand on me demanda pourquoi j’étais parti, je répondis : « parce que les communistes polonais ont considéré que j’étais leur ennemi, et moi je croyais toujours les communistes » (cette déclaration a été enregistrée dans le film « Je suis parti de Pologne, parce que… », mis en ligne sur le site Internet du musée Polin). Je percevais mon attitude comme s’inscrivant dans la suite des luttes des Polonais contre les « souverains » imposés par les Russes, et non pas comme le geste d’un « étranger ». C’est pourquoi, depuis le Danemark, j’ai essayé comme j’ai pu d’aider Solidarność que je voyais comme l’héritier naturel des révoltes polonaises pour l’indépendance.
Je ne pense pas que nous devenions des victimes en quittant la Pologne, même si c’est la vision victimisante diffusée par le musée Polin. Au contraire, cela nous donnait la possibilité de nous enrichir, non pas financièrement (je suis moi-même nettement moins riche que mes amis polonais), mais en termes de connaissance du monde et de nous-mêmes, ce que j’ai évoqué dans le magazine Znak n° 3 de 1996, dans l’article Trois.
Car j’ai acquis en partant trois identités que je continue de développer. J’écris en langue polonaise depuis toujours, et de temps en temps dans la langue de Kierkegaard. Depuis Mars 68, je m’intéresse à l’histoire des Juifs, et depuis vingt-sept ans je suis le mari d’une Danoise et j’ai une famille avec laquelle je m’exprime en danois. Pourquoi devrai-je rejeter l’une ou deux de ces identités en les qualifiant « d’étrangères » ? Combiner en soi les identités n’est-il pas la seule manière de protester efficacement contre les nationalismes fous qui nous poussent à la guerre ?
Je ne cherche pas à donner l’impression que ce processus s’est déroulé dans un bonheur et une harmonie totale. Avoir participé aux manifestations de Mars 68 était parfois source de fierté en Pologne, et le plus souvent c’était la cause de répressions. Au Danemark, cela ne signifiait rien du tout. Occupés à compter leur argent, les Danois n’avaient pas le temps de chercher à en savoir plus sur un pays inconnu. Souvent, mes demandes de bourses ou de travail restaient sans réponse. Une bonne âme protestante me dit un jour de ne pas indiquer sur mon CV que je m’étais battu contre le pouvoir communiste, que j’avais été persécuté et qu’on m’avait renvoyé de l’université. « Au Danemark, c’est le CV d’un délinquant », me souffla cette âme chrétienne. Les opportunistes sans scrupules se sont bien mieux adaptés. Au Danemark, j’ai rencontré beaucoup d’anciens membres de la police politique polonaise qui avaient soudain découvert qu’ils étaient victimes du communisme.
Réfléchissons maintenant aux implications de l’intitulé polonais pour ces « étrangers » restés au pays parce qu’ils se sentaient Polonais. Cette expression n’est-elle pas un peu facilement mise dans la bouche des nationalistes polonais, et ne renforce-t-elle pas leurs accusations comme quoi ces « étrangers » qui, pour des « raisons suspectes », restent en Pologne sont en réalité des menteurs (qui « font semblant » d’être des Polonais) et des lâches (parce qu’ils ont peur d’émigrer). N’est-ce pas une réduction trop facile de la leçon de Mars 68 ?
Copenhague, le 15 septembre 2017
Source : site Internet du Forum des Juifs polonais (Forum Żydów Polskich)
Source première : magazine philosophique et culturel trimestriel Kronos, n° 2/2017