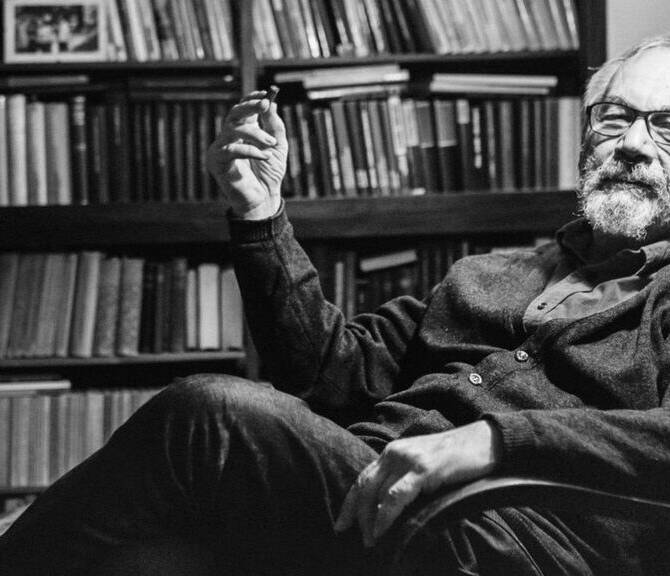Hongrie – Si la plus fameuse des mélodies de Joseph Haydn n’aura jamais cessé de résonner depuis le 12 février 1797, date d’un anniversaire de l’empereur François II, l’Hymne de Ferenc Kölcsey, rédigé à Szatmárcseke le 22 janvier 1823 (le 22 janvier est depuis 1989 la journée de la culture hongroise et, depuis 1996, le jour où est remis le prix littéraire Sándor Márai) et mis en musique pour la première fois par Ferenc Erkel en 1844, n’obtint sa qualité d’hymne national hongrois qu’en 1989.
Ce poème de Kölcsey est bien plus qu’une simple réponse à l’hymne impérial, le Gott erhalte, et peut se prendre comme un des principaux objets d’étude du caractère national hongrois. Ce dernier point fait d’ailleurs l’unanimité puisque même ceux étant dotés d’une oreille musicale des moins performantes s’accordent à dire que le rythme et les sonorités de la mélodie en question dégagent une impression de tristesse et de mélancolie, autrement dit des sentiments d’ordinaire exclus du champ des hymnes nationaux, qui, pour la plupart, jouent du registre de la fierté combative ou, du moins, ferment les yeux sur tout pessimisme.
Kölcsey n’est d’ailleurs pas dupe sur l’amour de la patrie qu’il entend insuffler par le biais de son poème. Bien que décédé avant l’échec de la révolte de 1848, il dit tout de cette défaite tragique et se laisse aller à des saillies d’un catastrophisme noir, notamment dans quelques uns de ses textes politiques, mais surtout dans Le Deuxième Chant de Zrínyi, un poème rédigé au seuil de sa mort en 1838 (Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat, / Vérkönnyel ázva nyög feléd!).
Issu des siècles agités du peuple hongrois, sous-titre du poème, l’Hymne de Kölcsey laisse entrevoir une Hongrie ayant payé ses années de gloire, victime de l’Histoire et suppliant Dieu de lui assurer un avenir paisible. L’hymne hongrois fait état d’une nation coupable de son aspiration à la grandeur. La Hongrie y accepte la sentence d’un Dieu punisseur ; une sentence si lourde que s’y résoudre revient aussi à payer les péchés futurs.
Très tôt orphelin et borgne, Kölcsey a trente-trois ans, l’âge christique, lorsqu’il écrit son Hymne. Il est à la fois rénovateur de la langue et introducteur de la critique littéraire en Hongrie, mais aussi un cas emblématique de tous les esprits à la formation classique s’étant heurtés à la diversité du moi, donnant ainsi sa raison d’être au romantisme littéraire et national. Cicéron et Plutarque sont les noms qu’invoque Kölcsey pour expliquer son chemin vers l’amour patriotique, vu comme un mode de vie et une consolidation de son âme romantique tourmentée.
Ce chemin a tout d’une pénitence appliquée à l’ensemble de la nation hongroise. Alors qu’il se refuse à voir dans la foi individuelle une obligation morale, Kölcsey fait au nom de sa patrie allégeance à Dieu et lui implore de la pitié. Il tient à faire savoir que son peuple se soumet à Dieu pour tempérer ses ardeurs et sait que Mongols et Turcs sont la marque d’une punition venue d’en haut. Promesse est faite : dorénavant les Hongrois resteront sages.
De cela procède le sentiment général, parfois un brin moqueur, suscité par l’écoute de cet hymne. Lenteur, tristesse, abattement, dépression et deuil sont les mots revenant en boucle. Déjà remanié par Ernő Dohnányi dans les années 30 — ce qui rendit l’oeuvre encore plus pesante, sans doute en raison du climat post-traumatique faisant suite à Trianon —, l’Hymne a en 2013 été accéléré pour coller aux normes du Comité international olympique ; son premier couplet peut désormais être entonné dans la limite du temps imparti.
Le premier vers de l’Hymne, « Dieu, bénis le Hongrois », constitue le titre du préambule de la nouvelle loi fondamentale hongroise entrée en vigueur en 2012, ce qui ne manque pas de rappeler l’histoire périlleuse de ce texte à travers les différents régimes politiques ayant existé depuis sa rédaction. En partie motivés par le fait que les premiers médaillés olympiques hongrois, Alfréd Hajós et József Bauer, aient eu à chanter l’hymne impérial aux jeux de 1896 et 1900, les députés hongrois proposent de donner valeur juridique à l’Hymne de Kölcsey en 1903. François-Joseph leur impose une fin de non-recevoir. Sous la régence de l’amiral Horthy, les salles de classes boudent Kölcsey pour y préférer le chant de psaumes. Sous la coupe de Moscou, Gyula Illyés et Zoltán Kodály refusent de créer un nouvel hymne.
Aujourd’hui, l’Hymne se chante solennellement, le visage passablement grave et toujours fermé. Il est la preuve que la nation hongroise est capable de connaître ses faiblesses et est passée reine dans la prévision de ses défaites, cueillant au passage quelques potentielles forces.
Hélas, tout comme l’immense majorité des nations, la Hongrie n’a pu faire face à la contamination des siens par les innombrables miasmes de la culture nord-américaine. En matière d’hymne, mettre la main droite sur le cœur et fermer les yeux suffisent à diagnostiquer la maladie. Le premier s’étant adonné à cette singerie n’est autre que Ferenc Gyúrcsány.
Bénis le Hongrois, ô Seigneur,
Fais qu’il soit heureux et prospère,
Tends vers lui ton bras protecteur
Quand il affronte l’adversaire !
Donne à qui fut longtemps broyé
Des jours paisibles et sans peines.
Ce peuple a largement payé
Pour les temps passés ou qui viennent.
Aux Carpates, sur ton conseil
Nos aïeux osèrent s’étendre.
Quelle belle place au soleil
Tu aidas nos pères à prendre !
Aussi loin que de la Tisza
Et du Danube le flot danse,
Aux fils héroïques d’Arpad,
Tu as prodigué l’abondance.
Tu fis onduler, à l’instar
Des mers, les épis dans nos plaines,
Et tu permis que du nectar
De Tokay nos coupes soient pleines.
Grâce à toi, nos drapeaux ont pu
Flotter chez le Turc en déroute,
Les murs de Vienne être rompus
Par Matyas et ses noires troupes.
Hélas ! nos fautes, trop souvent,
Ont fait éclater ta colère.
Et de tes nuages ardents
Tu as fait jaillir le tonnerre.
Alors ce furent les Mongols,
Leurs dards sifflants et leurs pillages,
Puis le Turc qui sur notre col
Posa le joug de l’esclavage.
Que de fois, sur l’amas sanglant
Des cadavres de nos armées,
Par les cris orgueilleux d’Osman
La victoire fut proclamée !
Que de fois, ô Patrie, enfin,
Tes propres enfants t’attaquèrent !
Et par leurs crimes tu devins
L’urne funèbre de leurs frères.
Fuir ! Mais d’asile il n’était point
Contre le fer et sa furie.
Dans son propre pays, en vain
Le fuyard cherchait sa patrie.
Il allait par monts et par vaux,
Pour compagnons, douleur et doute,
Pour horizon, du sang à flots,
Et des flammes pour clef de voûte.
Là, ces ruines furent un fort,
Autrefois y régnait la joie.
À sa place, un râle de mort
Et des plaintes de cœur qu’on broie.
La liberté ne fleurit point,
Hélas ! dans le sang des victimes !
Les yeux de l’orphelin sont pleins
Des pleurs de ceux que l’on opprime.
Prends pitié du Hongrois, Seigneur.
Si souvent il fut dans les transes !
Tends vers lui un bras protecteur
Dans l’océan de ses souffrances !
Donne à qui fut longtemps broyé
Des jours paisibles et sans peines.
Ce peuple a largement payé
Pour les temps passés ou qui viennent.
(Adapté du hongrois par Jean Rousselot en 1962)