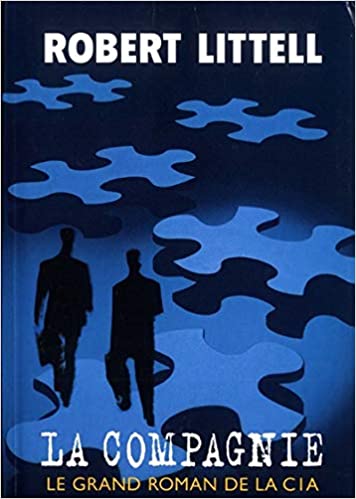Hongrie – Robert Littell est un ancien journaliste américain et auteur de romans d’espionnage à succès, dont La Compagnie : le grand roman de la CIA, paru en 2002, reste à ce jour l’un des plus puissants outils de compréhension des quarante années de guerre froide. Fruit d’un travail d’archives et de recherche colossal, ce roman de plus de 1 200 pages traite dans sa deuxième partie (« La fin de l’innocence ») des événements hongrois de 1956.
En mars 1956, des extraits du discours prononcé à huit clos par Nikita Khrouchtchev au XXème Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique sont révélés par le New York Times. Ce document, livré à la CIA par le Mossad, est souvent présenté comme un élément incontournable de la déstalinisation, autrement dit du processus entendant remettre en cause le culte de la personnalité et certaines décisions de Joseph Staline. Le souhait du premier secrétaire du PCUS de ne pas dévoiler les conclusions de ce Congrès, afin « de ne pas fournir des munitions à l’ennemi » et « de ne pas laver de linge sale sous ses yeux » n’aura ainsi mis que quelques jours à voler en éclat. Vient alors ce qui est communément admis : alors que Moscou craignait des réactions dans les pays satellites, Washington se frottait les mains, n’ayant jamais été aussi proche de faire tomber ces pays comme des dominos.
Rien n’en est moins sûr à la lecture du roman de Robert Littell, qui, mêlant personnages réels et fictifs, permet de comprendre que les États-unis, eux aussi, ont senti un risque suite à cette divulgation et se sont ensuite empressés de décourager les opposants hongrois de passer à l’action. Plus encore que l’attitude soviétique face aux événements hongrois, c’est cette empressement américain que Littell raconte.
La question de l’exactitude factuelle de l’opération souterraine menée par la CIA à Budapest à partir du 16 octobre 1956 contenue dans la narration de Littell est secondaire, tant elle se place dans une réalité géopolitique ne faisant aujourd’hui plus aucun doute aux yeux de ceux abordant le passé de manière sérieuse, qu’ils soient historiens professionnels ou non, et qui, en toute circonstance, évitent tout penchant idéologique et/ou romantique. Robert Littell appartient résolument à cette catégorie, rappelant au passage que, bien souvent, les auteurs anglo-saxons contemporains sont de bien meilleurs enquêteurs — adeptes d’un journalisme de la vieille école, surtout pratiqué outre-Manche et outre-Atlantique — que romanciers. Pour ces auteurs, l’étude des documents est d’une importance primordiale, ce qui, pour les lecteurs amateurs d’histoire, relaie l’aspect romanesque au second plan.
C’est sous la plume de l’Américain Robert Littell, qui ne s’est pourtant jamais manifesté par des positions favorables à Moscou, que l’on voit apparaitre un tout autre clivage que celui généralement choisi pour raconter le 56 hongrois. Le couple antithétique impitoyable pouvoir moscovite / courageux insurgés hongrois se voit ici doublé d’une autre opposition : impitoyable pragmatisme américain / romantisme hongrois. Littell va d’ailleurs plus loin en montrant que ce romantisme est en bonne partie dû à la propagande US, qui, notamment sur les ondes de Radio Free Europe, a incité les Hongrois à aller à la confrontation avec Moscou. Or, nous savons désormais que dès janvier 1956, le président Eisenhower avait sur son bureau un rapport de son administration excluant toute intervention en Hongrie à court et moyen terme[1]. L’insurrection hongroise écrasée, certaines têtes de la CIA, notamment Frank Wisner, se sont mordus les doigts d’avoir à ce point excité les opposants hongrois.
Par ailleurs, Robert Littell convoque Thucydide pour faire comprendre la particularité de l’insurrection de 1956, et plus largement du « caractère hongrois ». Selon l’historien athénien, la guerre a pour les hommes fondamentalement trois moteurs : la peur, l’honneur et l’intérêt. Omettant leurs intérêts, les Hongrois se sont battus pour leur honneur et parce qu’ils ne voulaient plus avoir peur, alors que les Américains ont refusé de s’engager car cela contrevenait à leurs intérêts immédiats.
S’étant exprimé en 1956, ce caractère hongrois n’est-il pas depuis allègrement dépassé ? Dirigée depuis l’étranger depuis plusieurs siècles, la Hongrie s’est régulièrement illustrée par des batailles pour l’honneur. Robert Littell, qui sait très bien que la Hongrie n’a pas les moyens de défendre ses intérêts — et ne cherche d’ailleurs pas à le faire, se contentant épisodiquement de faire comme si elle les défendait —, résume le caractère hongrois dans la bouche d’un leader des insurgés de 56 : « Pour les Hongrois, le fait qu’une situation soit désespérée ne la rend que plus intéressante. » Pour quiconque connaît la Hongrie et les Hongrois de prêt, cela résonne comme une cruelle banalité.
Il est tout aussi banal de constater la position US sur la Hongrie en 1956, quand on sait qu’Eisenhower — qui à ce sujet aurait déclaré : « J’aimerais les aider, mais je ne le peux pas. » —, était alors à un moment crucial dans la campagne pour sa réélection, alors que Français, Britanniques et Israéliens attaquaient l’Égypte de Nasser.
Peut-être ces considérations générales sur les moteurs de la guerre appartiennent-elles irrémédiablement au passé. La peur n’est plus un moteur, elle est désormais réconfortante, comme le montre actuellement le succès de la covidisation des esprits par des forces post-nationales en seulement quelques mois. L’honneur — ne nous y attardons même pas — n’est plus qu’une curiosité pour médiévistes. L’intérêt, vu comme ce qui dicte la technique, la tactique et la stratégie de gouvernement, est une notion déjà passablement éreintée depuis la fin de la guerre froide et semble de nos jours avoir totalement disparue, si l’on tient compte de la facilité avec laquelle les forces mentionnées plus haut tiennent à la gorge la totalité des gouvernements nationaux — ces vielles reliques dont la place est désormais au musée, celui dans lequel Robert Littell nous offre une visite magistrale.